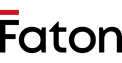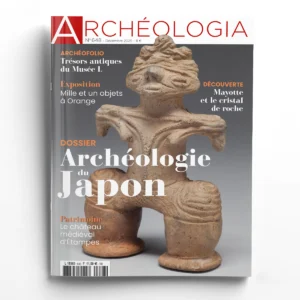Au Mobilier national, les regalia de Charles X ressuscitent le dernier sacre

L’enjeu est double. En se faisant sacrer, Charles X (1824-1830) entend refermer définitivement la parenthèse révolutionnaire. En 1814, Louis XVIII (1814/1815-1824) avait renoncé à l’idée, arguant qu’une cérémonie de ce type l’aurait inscrit dans la continuité directe des monarques d’Ancien Régime. Pour Charles X, le sacre constitue également l’occasion de se poser en souverain le plus puissant d’Europe. Le défi est de taille car, en 1821, le couronnement de George IV (1820-1830) avait ébloui le monde.

François Gérard (1770-1837), Charles X dans le grand habillement du sacre, 1824. Huile sur toile, 276 x 202 cm. Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Photo service de presse. © RMN-GP (château de Versailles) / Franck Raux
Les Honneurs de Charlemagne
La couronne dite de Charlemagne, recréée par Martin-Guillaume Biennais pour le sacre de Napoléon et restaurée par Jacques-Évrad Bapst, peut être tenue pour la pièce maîtresse de l’exposition. Redorée, sertie de camées et augmentée d’une toque de velours violet, elle constitue le plus important des « Honneurs de Charlemagne », ainsi que l’on a nommé, à partir du Premier Empire, l’ensemble des insignes du pouvoir. Un sceptre surmonté d’une représentation de Charles V (1364-1380) et une main de justice, eux aussi reconstitués, comptent également parmi les attributs de la puissance royale.

Couronne dite de Charlemagne, recréée en bronze doré pour le sacre de Napoléon en 1804, sur le modèle de celle de Charlemagne, disparue sous la Révolution. © Actu-culture.com / OPM
Haute joaillerie
Aux Honneurs de Charlemagne s’ajoutent la couronne et les bijoux personnels du roi, dont la confection est encore confiée à Bapst. Initialement conçue pour Louis XVIII, la couronne personnelle de Charles X est émaillée de huit fleurs de lys, de 1859 brillants et de 34 saphirs. L’exposition présente un moulage et une copie de l’objet, respectivement réalisés en 1853 et 1972. D’autres artefacts, comme le glaive et les habits du souverain, sont également constellés de diamants et de petits joyaux. Il n’est jusqu’à l’agrafe du manteau royal qui ne soit ornée d’une opale iridescente.

Attribué à Alexandre Desachy (mouleur, vers 1817-1886), moulage de la couronne de Charles X, 1853. Plâtre, 24 x 27 cm. Paris, Archives nationales, en dépôt à Reims, palais du Tau. Photo service de presse. © CMN / Pascal Lemaître
Une épée disparue
L’épée portée par Charles X lors de son sacre a été dérobée en décembre 1976. Seul subsiste son fourreau, présenté dans l’exposition. Unique réminiscence de l’un des plus somptueux insignes royaux, il permet de se figurer la forme et les dimensions de l’objet. L’épée, commandée par Louis XVIII, était sertie des Diamants de la Couronne. Son pommeau, conçu par Bapst, surmontait une lame fourbie par Charles-Louis Sirhenry. Présentée lors de l’Exposition universelle de 1855, elle avait été frappée des armes de Napoléon III.

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Charles X en costume de sacre, Album du Sacre de Charles X, folio 10. Lavis brun, encre noire, mine de plomb et dessin à la plume, 66 x 46,9 cm. Paris, département des Arts graphiques du musée du Louvre. Photo service de presse. © GrandPalaisRmn (Musée du Louvre) / Michel Urtado
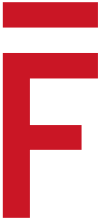
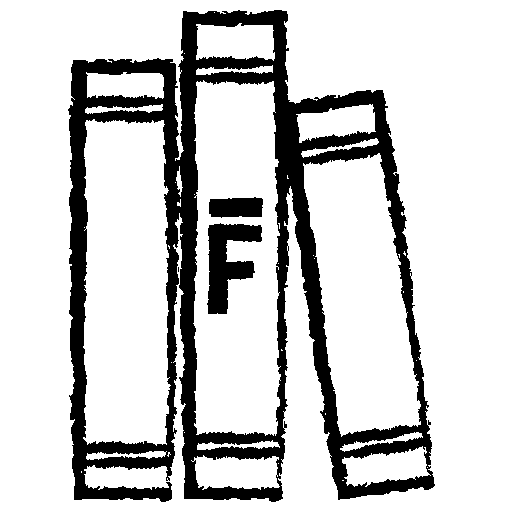
d’expertise éditoriale
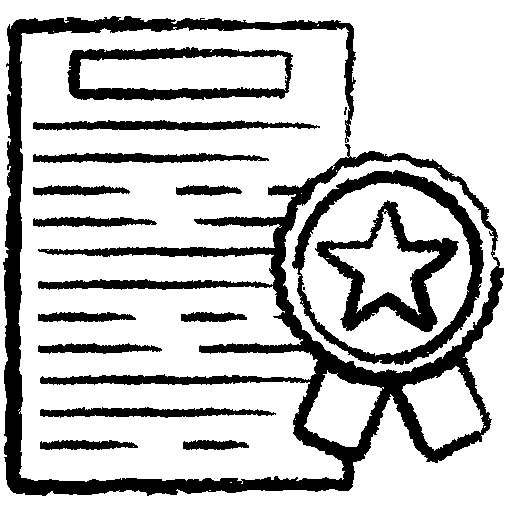
et fiabilité
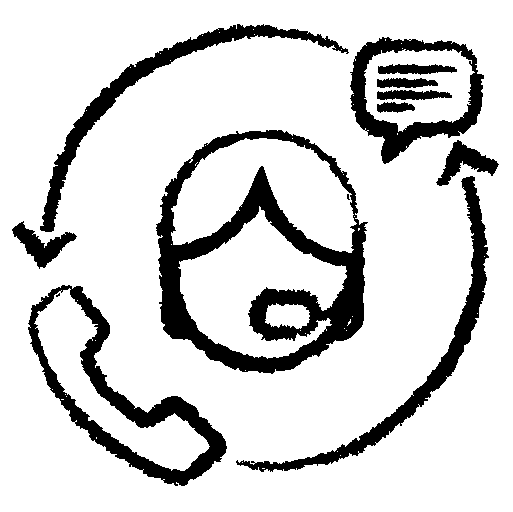
à l’écoute
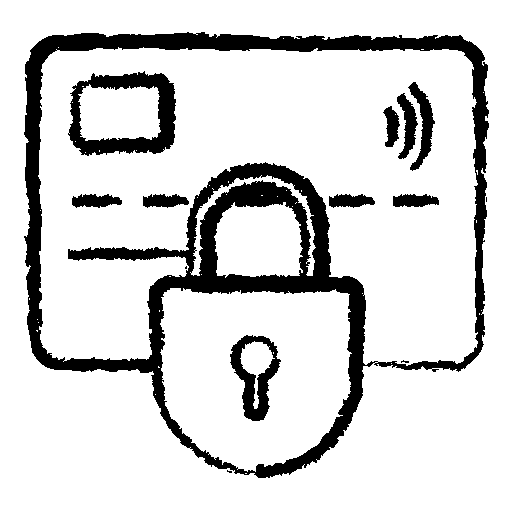
100% sécurisé