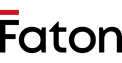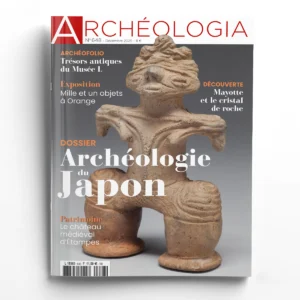Tuileries, Saint-Cloud, Meudon : les palais martyrs de l’Empire revivent au Mobilier national

Parachevant cette année de commémoration napoléonienne, le Mobilier national propose de redonner vie à la splendeur des Tuileries, de Saint-Cloud et de Meudon, trois « maisons royales » nées sous les ors de l’Ancien Régime que l’Empereur transforma en écrins de son nouveau pouvoir. Véritables fleurons parmi les 47 palais impériaux que compta l’Empire à son apothéose, ces trois résidences aujourd’hui disparues explicitent avec éclat, dès l’aube du XIXe siècle, les desseins du futur maître de l’Europe : d’abord témoins de sa volonté de rénovation monarchique, elles serviront bien vite de supports au déploiement de la grandiose grammaire symbolique napoléonienne, mêlant aigles, foudres, abeilles et couronnes. Exceptionnellement sortis des réserves de l’institution héritière du Garde-Meuble ou bien prêtées par nos plus prestigieux palais nationaux, près de 350 pièces de mobilier, bronzes dorés, tapisseries et soieries témoignent de l’excellence de l’artisanat français promu par Napoléon et viennent recomposer les fastes évanouis de ses palais fantômes.
Immortalisée par Victor Hugo, la fameuse « année terrible » de 1870-1871 prive la France de trois de ses plus beaux joyaux patrimoniaux. Le 13 octobre 1870, alors que les Prussiens occupent Saint-Cloud, un obus dévaste l’appartement de l’Empereur. Le feu dévorera, trois jours durant, le merveilleux palais de Philippe d’Orléans devenu résidence campagnarde de la famille impériale, n’en laissant que des ruines. Trois mois plus tard, malgré la signature de l’armistice le 28 janvier 1871, c’est au tour de Meudon de disparaître : après avoir miraculeusement échappé à d’intenses tirs d’artillerie, cette résidence du Grand Dauphin devenue celle du prince Jérôme Napoléon est victime le 31 janvier d’un obscur incendie, que l’on imagine aisément provoqué par l’occupant. Cette sinistre série s’achèvera le 23 mai, à l’aube de la « Semaine sanglante », dans la capitale alors aux mains des communards. Méticuleusement enduits de matières inflammables, les Tuileries disparaissent dans un formidable brasier. Contrairement au mythe forgé par Marx d’une fièvre incendiaire dictée par d’impérieux motifs tactiques, il s’agit ici d’anéantir un symbole honni : « les derniers vestiges de la royauté viennent de disparaître, s’enthousiasme le « général » Bergeret qui s’offre un souper froid devant le brasier : je désire qu’il en soit de même de tous les monuments de Paris ».
Les Tuileries : grande vitrine de l’art impérial
Au lendemain du coup d’État du 18 brumaire qui renverse le Directoire, les nouveaux « consuls provisoires » gagnent le palais du Luxembourg, avant de jeter trois mois plus tard leur dévolu sur les Tuileries. Comme le note Cambacérès dans ses Mémoires, le lieu est à la fois central et plus aisé à défendre. Le palais conserve encore le souvenir des règnes des Valois et des Bourbons, déployant les somptueux décors Louis XIV issus de la grande campagne conduite par Le Vau entre 1659 et 1666. Après de brefs travaux de rénovation destinés à rendre les lieux à nouveau habitables, Bonaparte s’installe dans l’appartement qu’occupèrent successivement les trois derniers monarques, tandis que Joséphine prend ses quartiers chez Marie-Antoinette. Les deux autres consuls héritent du pavillon de Flore et de l’hôtel d’Elbeuf situé à proximité. Cette répartition topographique annonce déjà la réalité du régime : le Premier Consul règne en maître. Offrant peu d’intimité ainsi qu’un accès limité à la nature, les Tuileries ne séduisent pourtant guère Bonaparte. Il leur préférera largement le palais de l’Élysée, racheté quelques années plus tard à Murat lors de son accession au trône de Naples en 1808, qui offrait l’agrément d’un vaste jardin. Le futur empereur n’aura cependant de cesse d’affirmer son pouvoir et ses ambitions dynastiques en embellissant l’ancien palais des rois : au chantier de la grille du Carrousel (1801-1802) succèdera, à l’avènement de l’Empire, celui de la chapelle (1805-1806), de l’arc de triomphe du Carrousel (1806-1808), ou encore de l’aile neuve (1807-1814). Conduisant le projet de la future rue de Rivoli, destinée à isoler le palais de la ville, il poursuivit le « grand dessein » séculaire de réunion du Louvre aux Tuileries initié par Henri IV, qui sera achevé par son neveu Napoléon III.

Manufacture des Gobelins, d’après Jacques-Louis de la Hamayde de Saint-Ange sur un carton de François Dubois, Les Grandes Armes de l’Empire français, portière pour le grand cabinet de l’Empereur aux Tuileries, 1808-1811. Tapisserie de laine et de soie, 325 x 235 cm. Paris, Mobilier national. Photo service de presse. © Mobilier national / Isabelle Bideau
Percier et Fontaine à l’œuvre
Menés sous la houlette de Percier et Fontaine, les travaux considérables mis en œuvre dans les espaces intérieurs des Tuileries visent deux objectifs : aménager de nouvelles salles destinées à prendre place au sein d’une topographie curiale repensée, et conduire une véritable politique décorative en modernisant l’ornementation de l’ensemble des appartements. Dans la perspective du sacre, le premier salon des Consuls est choisi pour accueillir le trône impérial, tandis qu’en suite est aménagé, dans leur ancien cabinet de travail, le grand cabinet de l’Empereur, destiné au Conseil des ministres, aux audiences diplomatiques et aux prestations de serment. La nouvelle chapelle est inaugurée au rez-de-chaussée du pavillon du Théâtre, tandis qu’est bientôt aménagée la salle dite « des Travées », conçue pour abriter les réunions du Conseil d’État. Une vaste salle de spectacle remplace enfin, en janvier 1808, l’ancienne salle des Machines, qui quelques années plus tôt hébergeait les séances de la Convention nationale.
« De la magnificence, de l’or, des tapisseries des Gobelins, de grands tableaux… »
D’abord modestes et dictées par l’urgence, les campagnes d’embellissement vont, à partir de 1805, déployer une politique décorative cohérente destinée à exalter l’art officiel, tout en favorisant l’essor des manufactures impériales. « De la magnificence, de l’or, des tapisseries des Gobelins, de grands tableaux… », réclame sans cesse l’Empereur, visiteur assidu du chantier. Allégories et figures mythologiques vont ainsi bientôt peupler les plafonds de ses appartements d’habitation, dont le mobilier est largement renouvelé.

Pierre-François-Léonard Fontaine, L’Empereur et l’Impératrice recevant les hommages de tous les corps de l’État le lendemain de leur mariage, vers 1810. Aquarelle, 28,5 x 26,5 cm. Paris, département des Arts graphiques du musée du Louvre.
Saint-Cloud : double campagnard des Tuileries où triomphe la couleur…
« Le château de Malmaison, malgré nos dépenses, malgré les accroissements que nous y avons faits, est devenu trop petit pour le Premier Consul », déplore Fontaine à l’aube du XIXe siècle. Vaste résidence suburbaine acquise par Bonaparte à son retour d’Égypte, Malmaison se révèle, malgré l’insistance de Joséphine, insuffisamment compatible avec les exigences de représentation qu’appellent les nouvelles fonctions de son époux. C’est au lendemain du 18 brumaire que celui-ci découvre pour la première fois Saint-Cloud, dont le Conseil des anciens occupe alors la galerie d’Apollon. Sa quête de résidence secondaire touche au but : parmi toutes les anciennes « maisons royales », elle est la plus proche de Paris et celle dont l’état se révèle le plus satisfaisant. Transformé par Hardouin-Mansart pour Philippe d’Orléans, le château avait été, au siècle suivant, profondément modifié par Richard Mique, à la demande de Marie-Antoinette qui en avait fait l’acquisition en 1784. Décrété en 1794 « maison nationale pour servir aux réjouissances du peuple », le lieu avait ensuite constamment été entretenu, conservant même ses glaces et tableaux de dessus-de-porte. Le choix de Bonaparte est arrêté : le 23 septembre 1801 débute le chantier de restauration. Près de trois millions de francs seront nécessaires afin de réviser les toitures, remplacer la plupart des planchers pourris par l’humidité, et moderniser les intérieurs. Affectés au service de l’État, les trois vastes salons de réception du corps central sont mis au goût du jour. Une grande toile circulaire de Prud’hon intitulée La Sagesse et la Justice descendant sur la Terre prend ainsi judicieusement place au plafond de la salle du Conseil d’État. Pour la salle à manger et celle des grands officiers, Fontaine déploie un décor d’inspiration pompéienne particulièrement coloré.

Pierre-Antoine Lebouc de la Mésangère, éditeur, Salle à manger du palais impérial de Saint-Cloud. Eau-forte, 26,8 x 37 cm. Paris, musée Carnavalet – Histoire de Paris. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet
… et au décor renouvelé
Réservé à l’habitation du Premier Consul et de son épouse, le premier étage de l’aile du Fer à cheval fait le pari de la couleur : du bleu ciel sur tous les plafonds, du lilas sur les boiseries du cabinet de toilette de Bonaparte, du brun Nankin et chocolat pour les antichambres, du serin (jaune pâle) dans le salon des petits appartements de Joséphine, du bleu lapis pour sa salle de bain… Livrés par le soyeux lyonnais Camille Pernon, de multiples tissus aux tons acidulés témoignent, dans l’exposition, des audaces colorées qui caractérisent alors la demeure consulaire. La proclamation de l’Empire transforme, en 1804, Saint-Cloud en résidence d’été officielle de Napoléon. De nouvelles adaptations se révèlent alors nécessaires : édictée en 1805, l’étiquette du palais impérial modifie à nouveau la décoration et la distribution des lieux. Les salons peints par Mignard se retrouvent ainsi au cœur du grand appartement de représentation, tandis que la salle du Conseil d’État se mue en salle du Trône. L’Empereur se démarque ainsi des Bourbons qui faisaient traditionnellement de la chambre de parade le centre du pouvoir.
« Ce nouveau décor ne suscitera cependant pas toujours l’enthousiasme »
L’enrichissement des décors se traduit notamment par l’embellissement des différentes cheminées à l’aide d’ornements de bronze exécutés par Pierre-Auguste Forestier, ainsi que par l’exécution de différents plafonds, à l’image de celui de la nouvelle salle du Trône, connu par une estampe de Percier et Fontaine. Ce nouveau décor ne suscitera cependant pas toujours l’enthousiasme ; pourtant volontiers flatteur, l’architecte Louis-Pierre Baltard l’appréciera ainsi en ces termes : « Pour le rendre digne de sa nouvelle destination, les artistes se sont efforcés d’en décorer les appartements dans le goût moderne. Mais, il en faut convenir, le contraste est trop frappant entre les appartements ainsi décorés et ceux qui le furent sous le règne de Louis XIV. Les derniers étalent une grandeur, des formes peut-être exagérées ; les autres n’offrent que ces gracieux mais légers ornements dont on a trouvé le modèle dans les maisons d’Herculanum et de Pompéi ».

Jacob Frères, d’après Charles Percier et Pierre-François-Léonard Fontaine, fauteuil gondole livré pour le boudoir de l’Impératrice au palais de Saint-Cloud (détail), 1802. Bois sculpté, peint et doré, couverture textile moderne, 77 x 56 x 61 cm. Rueil-Malmaison, musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Christian Jean
Meudon : une école pour les princes de l’Europe
Le 25 novembre 1810, un texte vient rétablir le statut de gouvernante des Enfants de France, en vigueur sous l’Ancien Régime, tandis qu’un règlement organise une véritable maison, service de cour dédié aux enfants mineurs de la famille impériale. Cette inscription dans la continuité des Bourbons sera complétée par l’attribution du château de Meudon à l’héritier du trône. Peu de temps avant la Révolution, le palais avait en effet accueilli, pour leur villégiature, les deux dauphins successifs que furent les fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le domaine servait alors d’écrin à deux édifices : le château-vieux, datant de la Renaissance et par la suite largement transformé par Louvois, et le château-neuf, bâti par Hardouin-Mansart pour accueillir le séjour du Grand Dauphin. Le jeune Louis XV y séjourna, ainsi que ses propres enfants. Incendié en 1795, le château-vieux fut rasé dans les premières années du XIXe siècle. En 1806, Napoléon envisage déjà d’y établir la résidence des princes de la famille impériale. Proposant de superbes vues depuis la grande terrasse dominant la Seine, Meudon a également l’avantage d’offrir un air particulièrement sain. Une bibliothèque de six mille volumes, un cabinet d’histoire naturelle, une salle de dessin et de fortifications, ou encore un observatoire, doivent y servir à l’éducation des jeunes princes, réunis autour de l’héritier du trône impérial, alors fils aîné de Louis et d’Hortense. Survenu en 1807, son décès prématuré enterrera provisoirement le projet.
« Il s’agit ainsi de faire de Meudon une vitrine des produits de l’industrie nationale. »
Ce n’est qu’en 1810 que Meudon revient sur le devant de la scène, lorsque le remariage avec Marie-Louise rend à nouveau possible l’affectation des lieux à un futur héritier. Afin de marquer cet élan nouveau, les armes de l’Empire viennent y chasser aux frontons celles ruinées du Grand Dauphin. Estimé à 300 000 francs, l’ameublement projeté ne doit, selon le vœu de l’Empereur, compter « que des meubles de Beauvais, des Gobelins et de la Savonnerie » et privilégier les bois français aux bois étrangers. Il s’agit ainsi de faire de Meudon une vitrine des produits de l’industrie nationale, tout en assumant les conséquences du Blocus continental, limitant drastiquement, puis interdisant à partir de 1811, l’emploi de coton et de bois exotiques. Datant de 1706, la distribution des lieux était demeurée inchangée : sur quatre niveaux, une double enfilade d’appartements desservie par un corridor central semblait toujours attendre le retour du Grand Dauphin et de ses invités. Situé à l’étage noble, l’appartement principal est désormais consacré à l’héritier du trône impérial. Huit appartements sont alors destinés à des princes. La naissance du roi de Rome, le 20 mars 1811, a en effet décidé l’Empereur à renouer avec son projet de collège de princes européens entourant l’héritier de la dynastie. Après un bref séjour de Madame Mère à l’été 1811, le roi de Rome s’y installe dès le mois d’avril 1812.

Grand Frères, dessin attribué à Alexandre-Théodore Brongniart, lé de tenture du premier salon de l’Empereur au palais de Meudon, 1808. Damas de soie, 140 x 54 cm. Paris, Mobilier national. Photo service de presse. © Mobilier national / Isabelle Bideau
La pratique du remploi : les fastes de la monarchie au service de l’Empire
Marie-Antoinette chez Joséphine
Partageant le goût raffiné de la dernière reine de France pour les objets précieux montés en pierres dures, Joséphine ne manqua pas de sélectionner, parmi ses anciennes collections, les meubles et objets d’art les plus délicats. Saint-Cloud en reçut notamment un certain nombre, à l’image des sièges sculptés en 1787 par Sené pour le grand cabinet de Marie-Antoinette, installés dans le salon de réception de l’appartement de Joséphine, et de deux tables en bois pétrifié appartenant à la souveraine. Le spectaculaire serre-bijoux de Schwerdfeger ornait, de son côté, le cabinet de toilette de l’Impératrice. La présence d’un meuble aussi important dans des espaces aussi intimes interroge : s’explique-t-elle par son statut de trésor destiné à n’être admiré que par quelques privilégiés, à la manière du cabinet des studiolo de la Renaissance ?

Jean-Ferdinand Schwerdfeger (ébéniste) et Pierre-Philippe Thomire (bronzier), serre-bijoux de Marie-Antoinette, 1787. Acajou, bronze ciselé, dorure, nacre, porcelaine, 258 x 200 x 67 cm. Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Fouin
Les objets d’apparat que la reine avait confiés à Daguerre en 1789 trouvèrent également leur place au sein de la chambre et du boudoir de l’appartement d’habitation de Joséphine, à l’exception de la fameuse collection de laques, qui demeura au Louvre. Aux Tuileries, on pouvait ainsi admirer le remarquable feu aux chameaux veillant anciennement sur le boudoir turc de Fontainebleau, ou encore la pendule de la chambre de la reine au Petit Trianon. Plusieurs pièces ayant appartenu à de grands collectionneurs du siècle passé, tels que le duc d’Aumont ou Lenoir du Breuil, complétaient l’ensemble. Preuve ultime de la fidélité de Joséphine à l’excellence de l’Ancien Régime : après son divorce, elle emporta plusieurs de ces vases à Malmaison.

Chenet d'une paire à chameaux couchés provenant du boudoir turc de Marie-Antoinette au château de Fontainebleau, vers 1785. Bronze doré, 34 x 25 cm. Paris, département des Objets d’art du musée du Louvre. © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier
L’art des Bourbons au service de l’Empereur
Guère attaché à ces reliques exquises, Napoléon ne se prive cependant pas de se servir au sein de l’ancien Garde-Meuble royal afin de conforter sa légitimité. L’inventaire du palais des Tuileries de 1807 nous dépeint ainsi la physionomie essentiellement Louis XVI de son appartement d’habitation. On retrouve, en effet, dans le troisième salon, la commode livrée par Stöckel pour la chambre du roi à Compiègne, dans la chambre à coucher, la commode en laque de Madame Victoire à Bellevue, ainsi que le lit et les fauteuils qui ornaient la chambre de Louis XVI à Saint-Cloud, un ensemble complété par l’étoffe que tissa Desfarges à Lyon en 1786 pour cette même pièce.

Desfarges, d’après Philippe de Lassalle, élément de tenture de la chambre de Louis XVI au palais de Saint-Cloud, 1786. Lampas broché fond taffetas, 278 x 182 cm. Paris, Mobilier national. Photo service de presse. © Mobilier national / Isabelle Bideau
À Saint-Cloud, le salon de Diane accueille des tapisseries des collections de Louis XIV aux côtés de deux cabinets sur piètement par André-Charles Boulle à l’effigie du Roi-Soleil. Particulièrement séduit par ce type de marqueterie, l’Empereur y réunira dix-huit meubles réalisés à l’aide de ce procédé, provenant de saisies effectuées chez le comte d’Artois, le baron de Breteuil ou encore le prince de Condé. On y expose également un bas d’armoire en laque agrémenté de bronzes dorés, partiellement dû à Riesener, qui renfermait, en l’hôtel du Garde-Meuble, les diamants de la Couronne. Les créations de pierres dures semblent également séduire Napoléon qui installe dans son grand cabinet deux cabinets à tableaux de pierres, dus à Joseph Baumhauer, emportés par Louis XVI lors de la vente du duc d’Aumont. À mesure que prennent de l’ampleur les commandes aux manufactures et aux artisans officiels du régime, ces remplois seront de plus en plus ciblés. Longtemps considérée comme une mesure dictée par l’urgence, cette pratique fut pourtant vraisemblablement moins induite par la contrainte que par son propre goût, conjugué au souci d’affirmation de son prestige.

Joseph Baumhauer dit Joseph, cabinet de Louis XVI pour le musée du Louvre, vers 1770. Ébène, mosaïque de pierres dures, 102 x 77,7 x 49,3 cm. Paris, département des Objets d’art du musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (Château de Versailles) /image RMN-GP
Les hommes de l’Empereur
Napoléon réunit autour de lui une garde rapprochée de fournisseurs qui mettront l’excellence de leurs arts respectifs au service de la gloire de l’Empire.
Les architectes et décorateurs
« Nous jouissons depuis plus de trente ans dans un accord parfait des douceurs d’une amitié qui n’a jamais été troublée et ne finira qu’avec nous », confie en 1816 Pierre Fontaine. Inséparable de Charles Percier, il n’aura de cesse d’œuvrer avec lui à l’élaboration et au rayonnement du style Empire. Promoteurs de la pompe impériale, ils contribuèrent notamment aux Tuileries et à Saint-Cloud à la redéfinition du cadre de vie du nouveau César.

Lacostat et Trollier, dessin attribué à Alexandre-Théodore Brongniart, étoffe pour assise de siège du deuxième salon des grands appartements de Meudon, 1808-1809. Gros de Tours broché, 79 x 54 cm. Paris, Mobilier national. Photo service de presse. © Mobilier national / Isabelle Bideau
Les menuisiers et ébénistes
Dirigée par les fils de Georges Jacob installés rue Meslée, la maison Jacob Frères livrera le Directoire puis le Consulat, jusqu’en 1803. Après la mort de son frère aîné, François-Honoré-Georges Jacob dit Jacob-Desmalter s’imposera comme le principal fournisseur du régime, meublant tous les palais impériaux pour un montant total estimé par Hector Lefuel à 2 248 461 francs. Les plus prestigieuses commandes sont attachées à son nom : salles du Trône de Saint-Cloud et des Tuileries, grand cabinet parisien de l’Empereur et chambre de Joséphine. Second fournisseur impérial par la quantité de mobilier livré, Pierre-Benoît Marcion œuvre pour le Garde-Meuble dès 1805. Il intervient notamment dans l’aménagement de la salle des séances du Conseil d’État dans l’aile nord des Tuileries, et fournit entre autres à Saint-Cloud divers meubles pour les petits appartements de l’Empereur.

Vue dans l’exposition du trône des Tuileries par Jacob-Desmalter. Photo service de presse. Thibaut Chapotot
Le tabletier
Orfèvre de l’Empereur, Martin-Guillaume Biennais ne limite cependant pas sa production aux services d’argent ou de vermeil couvrant la table des Tuileries. Reçu maître tabletier avant la Révolution, il profite habilement de la suppression des corporations pour diversifier sa production en l’ouvrant à l’ébénisterie puis à l’orfèvrerie. Fournissant Bonaparte dès le Consulat – on lui doit notamment l’extraordinaire athénienne en if et bronze doré ornant sa chambre aux Tuileries – il poursuivra son ascension sous l’Empire. Il livrera ainsi les douze flambeaux destinés à la salle des séances du Conseil d’État aux Tuileries, ainsi que de nombreuses écritoires, l’une de ses spécialités. Désormais conservée à Fontainebleau, l’une d’entre elles y sera d’ailleurs utilisée afin de signer l’abdication de 1814.

Martin-Guillaume Biennais, écritoire du grand cabinet de l’Empereur au palais des Tuileries, 1813. Vermeil, 17 x 37 x 22 cm. Paris, Mobilier national. Photo service de presse. © Mobilier national / Isabelle Bideau
Les bronziers
Devenu le grand maître du bronze impérial après avoir servi la monarchie durant la dernière décennie de l’Ancien Régime, Pierre-Philippe Thomire prend, au début du siècle suivant, une ampleur inédite en s’offrant, à la veille de la proclamation de l’Empire, le fonds de commerce de Lignereux, marchand de dorure et de meubles qui succéda au marchand-mercier Daguerre. Tous les palais impériaux accueillent bientôt ses fastueuses créations. Aux Tuileries, la chambre de l’Empereur reçoit ainsi en 1809 l’extraordinaire pendule de L’Histoire écrivant, tandis que son grand cabinet se pare, deux ans plus tard, de candélabres monumentaux exécutés d’après un dessin de Percier et Fontaine retouché par David. Éclipsé par l’immense gloire que connut l’art de Thomire, Antoine-André Ravrio fut pourtant en son temps l’un des principaux artisans du développement de l’industrie du luxe en ce début de XIXe siècle. Il fournit régulièrement chenets, bras de lumières, lustres et flambeaux pour les Tuileries, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Saint-Cloud ou encore le château de Versailles et le Petit Trianon.

Pierre-Philippe Thomire, mouvement de Lepaute, pendule L’Histoire écrivant, 1809. Bronze patiné et doré, marbre griotte, 74 x 40 x 19 cm. Paris, Mobilier national. © Mobilier national / Isabelle Bideau
L’entrepreneur de cristaux
Héritier d’une dynastie familiale qui se forgea un nom dans l’industrie du verre, Benjamin-François Ladouëpe du Fougerais est, à l’aube de l’Empire, aux commandes de la cristallerie de Montcenis située au Creusot. Largement endettée après la chute de la monarchie, elle recevra en 1806 grâce à son action le titre envié de « manufacture des cristaux de S.M. l’impératrice et reine ». Les nouveaux besoins nés de l’évolution du service de table vont permettre une diversification de la production, proposant désormais lustres, verres de couleur, services à dessert… Les factures conservées dans les archives de la Maison de l’Empereur témoignent de nombreuses livraisons pour les Tuileries, Fontainebleau, ou encore Compiègne.
Marchands d’étoffes, passementiers et brodeurs
Après avoir dans l’urgence puisé dans les stocks hérités de la monarchie, le nouveau régime relance massivement sa politique de commandes officielles aux manufactures. Celle-ci bénéficie tout particulièrement à la puissante industrie des soyeux lyonnais. Considéré « à tous les égards et sans comparaisons le premier à Lyon », Camille Pernon fut, dès 1802, particulièrement sollicité par le Premier Consul pour parer Saint-Cloud de tissus. Il régna jusqu’en 1807 sur les fournitures d’étoffes destinées aux palais impériaux, jusqu’à ce que la malheureuse décoloration du damas vert livré pour le cabinet de l’Empereur à Saint-Cloud ne vienne ternir son étoile. L’Almanach des modes et Annuaire des modes de 1815 témoigne de l’importance que prend, sous le Consulat puis l’Empire, le métier de passementier. Au sein de la profession, un nom semble s’imposer : installé à Paris et largement sollicité par le Garde-Meuble impérial, François-Joseph Gobert livre crêtes, franges, embrasses et glands destinés à orner à Saint-Cloud la salle du Trône, et fournit en passementerie la petite chambre à coucher de Joséphine à Fontainebleau. Particulièrement prisé dans les domaines de la mode et du costume militaire, l’univers de la broderie est, après la période révolutionnaire, dominé par les figures d’Augustin Picot et Jean-François Bony. C’est ainsi au premier que l’on doit le semis de 4 050 abeilles d’or peuplant le dais du trône des Tuileries, tandis que le second livrera de nombreux dessins d’ornements pour les robes de l’impératrice Joséphine.

Camille Pernon, bordure tranversale destinée à la bibliothèque du Premier Consul à Saint-Cloud (détail), 1806. Brocart or fond ponceau, 56 x 402 cm. Paris, Mobilier national. © Mobilier national, droits réservés
« Les palais disparus de Napoléon Ier », du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022 dans la galerie des Gobelins du Mobilier national, 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris. Tél. 01 44 08 53 49. www.mobiliernational.culture.gouv.fr
Catalogue sous la direction de Thierry Sarmant, in Fine, 496 p., 49 €.
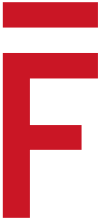
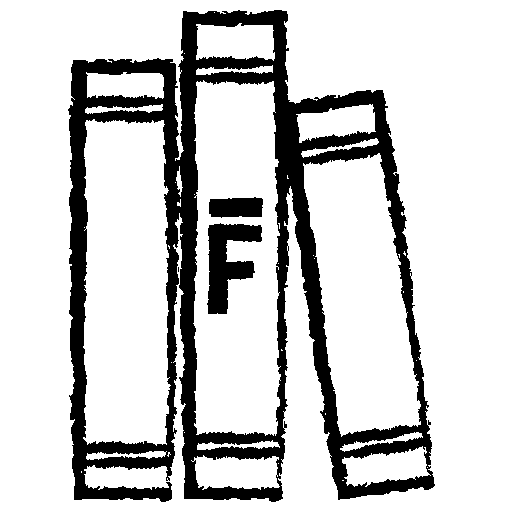
d’expertise éditoriale
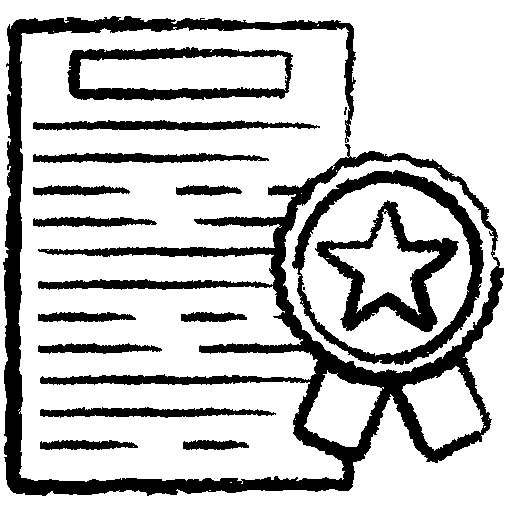
et fiabilité
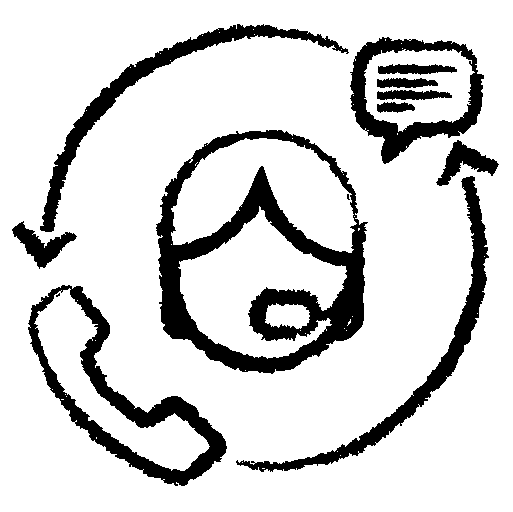
à l’écoute
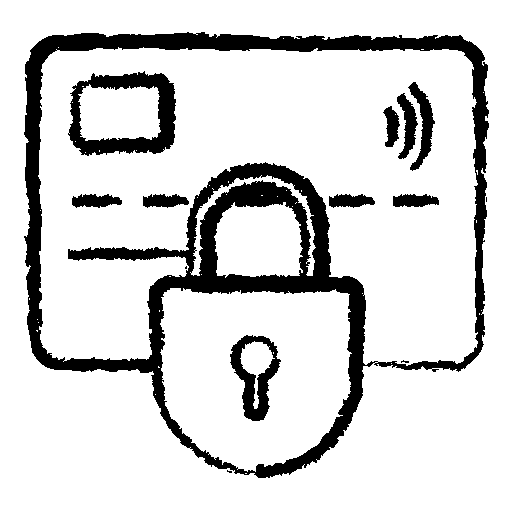
100% sécurisé