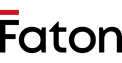Dans les pas de Rembrandt au musée des Beaux-Arts de Draguignan

Point de « Triste hôpital tout rempli de murmures » où « la prière en pleurs s’exhale des ordures », sauvé par la magie du fameux « rayon d’hiver » qui le traverse. À chacun son Rembrandt, et celui, doloriste et sordide, des Phares (1857) de Baudelaire n’est essentiellement pas celui qui attira l’attention croissante des Français entre 1710 environ et la fin de l’Ancien Régime.

Prologue
Soulignons que Rembrandt n’avait nullement été ignoré par le XVIIe siècle français. Dès 1641, le Tourangeau Claude Vignon avait prié François Langlois, dit « Ciartres » ou « Chartres », marchand, libraire, éditeur de gravures et virtuoso, de lui transmettre ses salutations confraternelles à Amsterdam et de tâcher de rapporter quelques-unes de ses œuvres. En outre, les curieux français connaissaient le Hollandais comme graveur (idiosyncrasique).
Toutefois, son art se révéla peu assimilable par le goût français à l’apogée du Grand Siècle. L’entrée dans les collections louis-quatorziennes, au début des années 1670, de l’admirable Autoportrait « au chevalet » (1660, Louvre), d’une provenance incertaine, constitue certes un jalon. Le silence entourant une œuvre battant si ouvertement en brèche l’idéal du peintre gentilhomme, emperruqué et « bien mis », doit cependant être relevé.

Le regard de Félibien
Laudateur inconditionnel de Poussin, Félibien (Entretiens, 1685) trouve pourtant à Rimbrans « beaucoup d’art », vantant sa science des teintes et des demi-teintes ainsi que celle des lumières et des ombres, autant de points cruciaux pour les futurs émules de Rembrandt au XVIIIe siècle. Qualifié de peintre « assez universel », ce dernier est alors considéré exclusivement à travers la singularité technique de son art du portrait – caractérisé, selon Félibien, par une dissociation des touches. Considérées à bonne distance, autre notion capitale, celles-ci se recomposent pour rendre avec « effet » et « rondeur » un visage qui, de près, pouvait apparaître comme un affreux chaos. D’ailleurs, concédait Félibien, « plusieurs personnes ont fait cas de ses ouvrages ».

L’importance de l’illusionnisme
Un tournant (relatif) s’amorce avec Roger de Piles (Abrégé de la vie des peintres [1699] et Cours de peinture par principes [1708]). Probable propriétaire de la Jeune fille à la fenêtre de Rembrandt (1645, Londres, Dulwich Picture Gallery), dont on verra dans l’exposition une copie française pataude du XVIIIe siècle (Orléans, musée des Beaux-Arts), cet influent théoricien situa le débat de l’excellence sur le terrain de l’illusionnisme. Cette jeune fille était si « vraie » que, placée par Rembrandt devant une fenêtre, elle abusait les passants.
Cet art de tromper le regard reposait, pour de Piles, sur la maîtrise du coloris (qualité cruciale pour un critique qui s’était précédemment signalé comme thuriféraire de Rubens), auquel était agrégée la distribution des lumières et des ombres, autrement dit le clair-obscur. Dans le même temps, de Piles découplait l’excellence d’une peinture et le caractère noble ou ignoble de son sujet. Cette humble servante (peu obligeamment surnommée « La Crasseuse » dans la France du XVIIIe siècle) pouvait ainsi donner matière à un admirable tableau. Idée féconde…

Le « moment Rembrandt »
Forte de quelque 70 peintures, dessins et gravures, l’exposition conçue par Yohan Rimaud éclaire avec intelligence le moment où Rembrandt s’impose, pour la première fois, au premier plan de l’horizon culturel français. Se nourrissant mutuellement, deux dynamiques concoururent à cette élévation : un infléchissement du goût, à partir de la Régence, qui fait davantage rechercher les peintures « du Nord » par les amateurs les plus distingués et l’essor du marché de l’art qui les leur procure.
Le XVIIIe siècle voit, en effet, Paris s’affirmer comme principal lieu du négoce de la peinture en Europe. Les tableaux attribués à Rembrandt convergent alors par centaines en France chez les curieux, les marchands, mais aussi les artistes, avant de circuler en Europe, de Londres à Saint-Pétersbourg.

La question délicate de l’attribution
Mais de quel Rembrandt parle-t-on ? L’un des aspects stimulants de l’exposition est qu’elle oblige à questionner la réalité, très fluctuante, de l’attribution. Obsédée par la (sainte) notion d’autographie, l’histoire de l’art moderne a prétendu (bien plus que ne l’avait fait le XVIIIe siècle qui amorça pourtant le mouvement) séparer le bon grain de l’ivraie. Rembrandt or not Rembrandt ? Il en résulta maints déboires, les mécanismes de l’atelier au XVIIe siècle, l’intrication de l’œuvre du chef d’atelier et de ses assistants et élèves rendant anachronique, sinon vaine, une telle prétention.

Un ensemble hétérogène
Les sujets de Louis XV et de Louis XVI regroupaient sous le nom du peintre hollandais un ensemble hétérogène où ne figuraient pas que des œuvres autographes (il s’en faut de beaucoup) ni même de bons tableaux d’atelier. Parfois attribuée à Carel Fabritius ou Samuel van Hoogstraten (avec une très hypothétique participation de Rembrandt), la Jeune fille au balai, prêtée par Washington, représente joliment ces tableaux rembranesques de bonne qualité figurant – comme Rembrandt – chez les grands amateurs français au XVIIIe siècle (Pierre Crozat et ses héritiers, en l’occurrence).
Mais la réputation du maître pouvait aussi être défendue, de manière bien moins flatteuse, par des tableaux d’épigones hollandais, des pastiches ou des copies plus ou moins frauduleuses, corpus équivoque dont l’exemple, néanmoins, s’inscrivit profondément au cœur de l’art français du temps.

Peindre comme Rembrandt
La vogue de Rembrandt, sa virtuosité de coloriste et son impressionnante maîtrise du clair-obscur suscitèrent de premiers émules français parmi les artistes faisant transition entre le Grand Siècle et celui des Lumières : Rigaud, Santerre ou Grimou, à l’honneur à Draguignan. C’est essentiellement le portraitiste et l’auteur de pittoresques « figures de fantaisie » qui fut alors pris pour modèle. La frontière entre les deux peut être floue chez Rembrandt, et les spectateurs du temps (comme nos contemporains du reste) n’étaient pas toujours capables de faire la part des choses entre ces catégories voisines, mais bien distinctes.
Rigaud, cependant, dans sa Présentation au temple (1726, Louvre), produit de manière précoce un singulier petit tableau d’histoire « néo-rembranesque » qui ne chasse pas la démesure tragique d’un héritage dont d’autres se bornent souvent à recueillir la séduisante écume.

Au fil des générations
De salle en salle, à travers de fort beaux prêts, on appréhende ensuite avec intérêt comment les générations suivantes – Charles Antoine Coypel, Jean-François de Troy, Jean-Baptiste Oudry, Jean Siméon Chardin, Jean-Baptiste Greuze ou Jean Honoré Fragonard – décantèrent le legs de Rembrandt pour l’adapter à leur dessein et au goût de leur clientèle. Le regard aigu porté ici sur ces artistes (pasticheurs habiles, copistes loyaux ou héritiers expérimentaux d’une touche « dissociative » ouvrant la voie à la modernité) illustre tout le profit qui peut être tiré de l’étude de la réception des grands maîtres dans le temps long. Une véritable exposition d’historien de l’art, très recommandable.

« Le Phare Rembrandt. Le mythe d’un peintre au siècle de Fragonard », jusqu’au 14 mars 2026 au musée des Beaux-Arts de Draguignan. mba-draguignan.fr
Commissariat : Yohan Rimaud. Catalogue (collectif), éd. In Fine, 272 p., 35 €

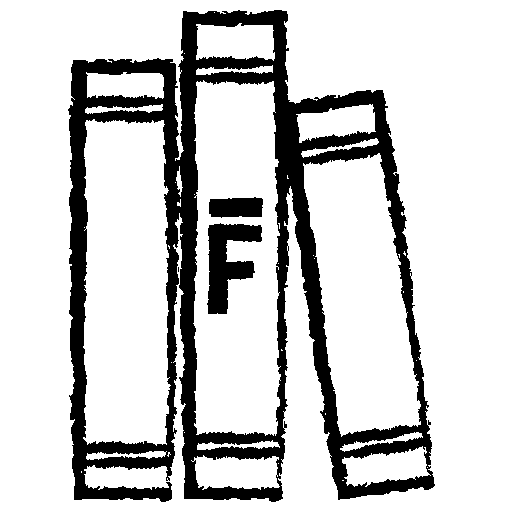
d’expertise éditoriale
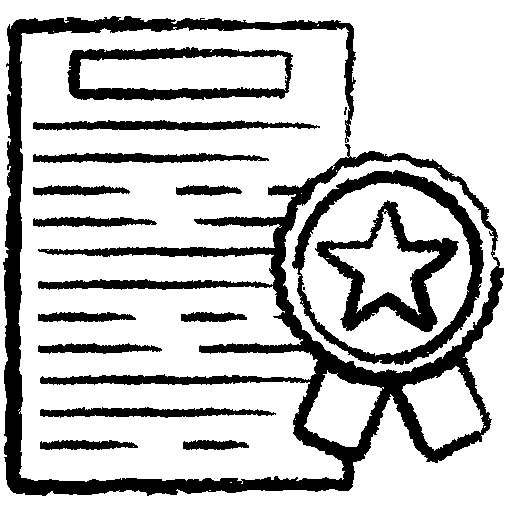
et fiabiltié
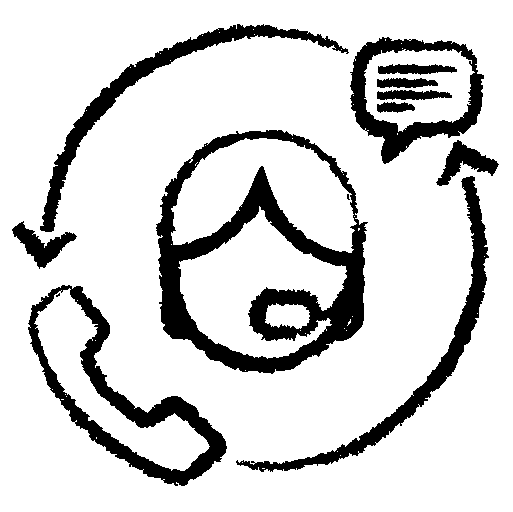
à l’écoute
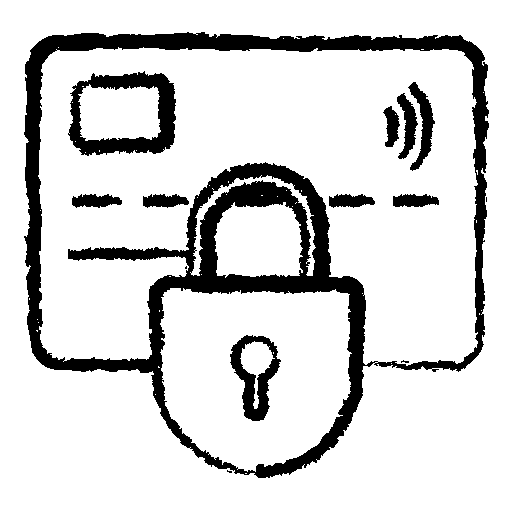
100% sécurisé