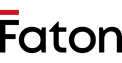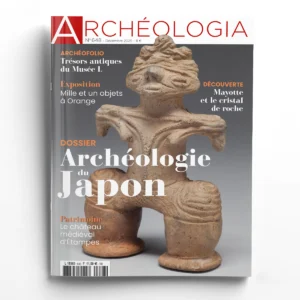La maison Fragonard dédie un musée au costume arlésien

En cinq ans, les travaux menés par le studio KO (qui a créé le musée Yves-Saint-Laurent de Marrakech) et l’architecte du patrimoine Nathalie d’Artigues ont redonné toute sa noblesse à l’édifice qui au siècle dernier abrita une maternité puis un hôtel de tourisme. La scénographie, résolument contemporaine et d’une grande sobriété, déploie dans les salles d’exposition un « noir manganèse » qui rappelle les noirs des costumes arlésiens. Selon la volonté des trois sœurs qui président à la destinée de la maison de parfums Fragonard, le lieu a ainsi été transformé en un écrin sur mesure pour l’extraordinaire collection de textiles provençaux réunie par leur mère Hélène Costa (décédée en 2007). Cette dernière avait fondé en 1997 le musée provençal du Costume et du Bijou de Grasse, mais depuis l’acquisition récente du précieux fonds de costumes de Magali et Odile Pascal, l’aventure a pris une nouvelle tournure. En effet, la fusion de ces deux ensembles complémentaires donne à voir pour la première fois une histoire de la mode et du costume arlésien tant dans sa dimension historique que régionaliste.

La cour du musée de la Mode et du Costume à Arles. © Andrane de Barry
« Le costume arlésien est bien plus qu’un simple folklore. Il est un moyen d’expression pour les femmes depuis le XVIIIe siècle. » Odile Pascal
L’exposition inaugurale
Depuis 1930, la « petite Rome de Gaule » élit tous les trois ans sa Reine d’Arles, une tradition perpétuée par les jeunes générations qui ne cessent de réinventer l’art de se costumer à l’occasion des fêtes traditionnelles, des célébrations familiales et parfois même dans la vie quotidienne. L’exposition inaugurale « Collections-Collection » met en scène l’histoire de la mode du XVIIIe siècle au tout début du XXe siècle au fil d’une quarantaine de silhouettes, d’accessoires, de tableaux et de documents d’archives, qui témoignent de l’influence de la mode nationale sur la Provence.

Robe de mariée arlésienne, vers 1830-1835. Arles, musée de la Mode et du Costume. © DR
À la mode arlésienne
Cette silhouette constitue une véritable leçon de mode arlésienne : l’imposante coiffe ornée d’un étroit ruban noir est typique des années 1820, de même que la paire de longues boucles d’oreilles pendantes en or, dites « fileuses ». Le corsage court de type spencer, en soie noire au large décolleté bordé d’un volant de dentelle, dévoile un fichu plissé croisé sur la poitrine sur lequel repose une croix arlésienne suspendue à un long ruban. La jupe à taille haute est en toile de coton imprimée.

Ensemble de jour inspiré du tableau de Michel-Philibert Genod, Arles, vers 1820. © Fanny Terno

Michel-Philibert Genod (attribué à), Portrait de jeune femme en costume d’Arles, vers 1820. Miniature sur ivoire. © DR
La passion des rubans
Les rubans d’Arles témoignent de la virtuosité de l’industrie textile stéphanoise tout au long du XIXe siècle. « Les rubans sont l’or de l’Arlésienne » explique Clément Trouche, directeur du musée. Pièce majeure du costume, le ruban de coiffe apparaît vers 1820, il est le plus souvent confectionné dans un velours de soie façonnée, dans des couleurs chatoyantes, agrémenté de toutes sortes de motifs. Mesurant jusqu’à 1,50 m, il est savamment enroulé en trois tours autour de la coiffe au sommet de laquelle il tient en équilibre.

Rubans de coiffe d’Arles en velours de soie façonnée, vers 1835-1845. © Fanny Terno
Le costume arlésien, un patrimoine vivant
L’Arlésienne suit la mode française et s’en inspire mais elle crée sa propre mode ! Les femmes portent le costume jusqu’au début du XXe siècle tout en le transformant constamment. Il n’y eut jamais aucune production textile locale, cependant la position de la ville d’Arles à la croisée de routes fluviales, maritimes et terrestres et la proximité de la célèbre foire de Beaucaire où se vendaient des étoffes en provenance du monde entier permirent un très grand choix pour l’élaboration des toilettes.

Ensemble de costumes arlésiens portés entre 1850 et 1875. © Fanny Terno
L’élégance d’un bouton d’or
Cette splendide robe à la française a été acquise juste après le lancement du projet du musée en 2019. Elle symbolise toute l’élégance de la haute société parisienne, par la préciosité de l’étoffe dans laquelle elle est taillée, son ampleur et les paniers qui la structurent.

Robe à la française, vers 1785-1789. © DR
Musée de la Mode et du Costume, 16 rue de la Calade, 13200 Arles. Tél. 04 90 18 37 37. musee-mode-costume.fragonard.com
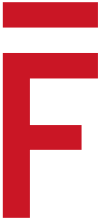
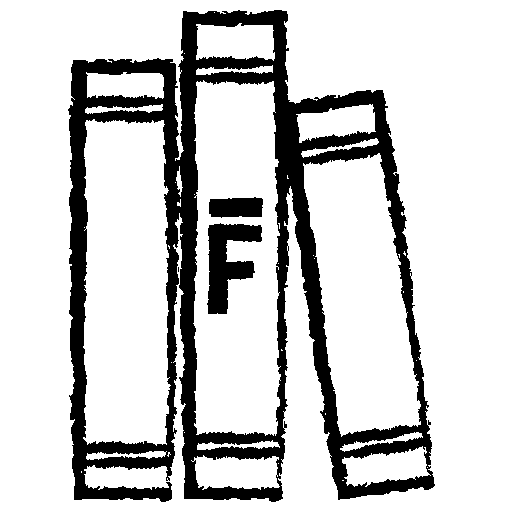
d’expertise éditoriale
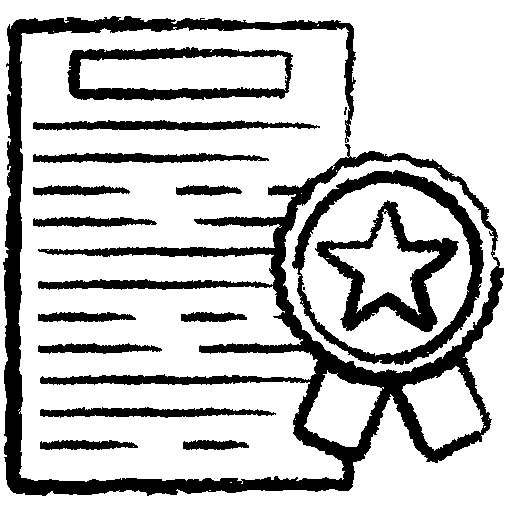
et fiabilité
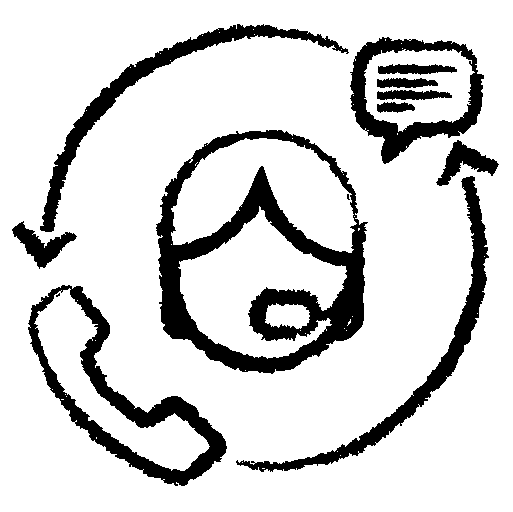
à l’écoute
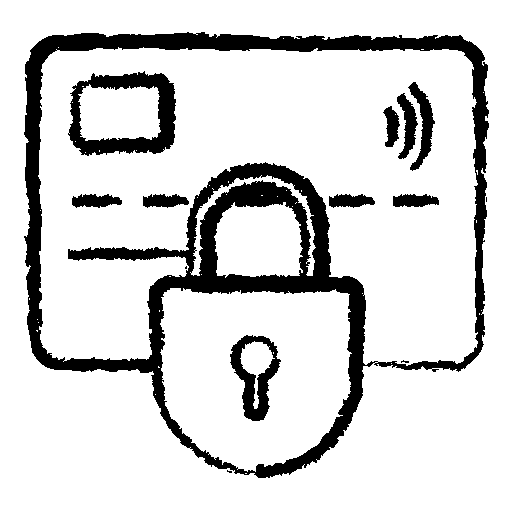
100% sécurisé