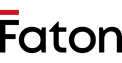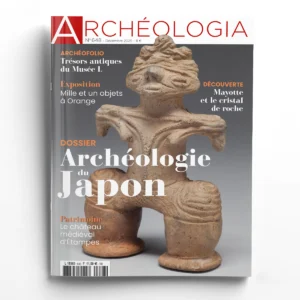Le parc de Jeurre, un écrin enchanté pour Méréville

À moins d’une heure de route de Paris, le domaine de Jeurre abrite les joyaux rescapés d’un parc dont le nom, anagramme de « merveille », symbolise à lui seul le raffinement et la douceur de vivre si chers au XVIIIe siècle : Méréville.
Durant la deuxième moitié du règne de Louis XV triomphe un financier dont l’insolente réussite préfigure celle des Rothschild : Jean-Joseph Laborde (1724-1794). Ce Béarnais a connu une ascension fulgurante, devenant à trente ans l’un des hommes les plus riches de France, fermier général puis banquier de la cour avant d’être fait marquis en 1785. Un an plus tôt, il avait été contraint de vendre au duc de Penthièvre le château et le parc de la Ferté-Vidame qu’il avait pourtant aménagés à grands frais. Il acquiert alors pour 850 000 livres auprès de Philippe de La Tour du Pin la seigneurie de Méréville près d’Etampes, idéalement située à une demi-journée à cheval de Paris. Après avoir annexé quelques parcelles voisines, Laborde se retrouve à la tête d’un colossal domaine de 1 253 hectares de terres, 120 hectares de bois et 60 hectares de prés. Déjà âgé de soixante ans, le puissant banquier va pourtant ouvrir là un nouveau chapitre de son existence en se muant en démiurge, transformant dix années durant grâce à l’aide de quatre cents ouvriers une terre quelconque en un jardin enchanté. Il fait d’abord remanier le château par son architecte Barré qui, sous l’influence de la vogue « romantique » de l’époque, lui conserve son allure médiévale tout en ajoutant deux ailes de facture classique. Fastueux, les aménagements intérieurs seront comparés par Vigée Le Brun à ceux d’une « habitation royale ».
Les jardins du « poète du temps »
Mais malgré le luxe déployé, ce somptueux château n’aurait sans doute pas seul suffi à faire entrer le domaine dans la légende si ses jardins avaient conservé l’aspect de modeste parc à la française qui était le leur lorsque Laborde en fit l’acquisition. Qu’au seuil de la vieillesse cet homme auquel tout a réussi se lance dans l’aménagement d’un aussi vaste jardin peut étonner. Il convient d’abord de rappeler l’ampleur de la folie horticole agitant les élites de cette deuxième moitié du XVIIIe qui, du duc de Chartres à Paris, au marquis de Girardin à Ermenonville, couvrent leurs domaines de jardins remarquables. Dans l’ouvrage qu’ils consacrent au seigneur de Méréville, François d’Ormesson et Jean-Pierre Thomas assimilent même ce défi à relever à une quête transcendante : « le jardin est considéré comme le domaine le plus préhensible de l’immortalité puisqu’il constitue une œuvre d’art vivante destinée à survivre à son fondateur […] ». Symbole du pouvoir par excellence depuis l’Antiquité, il ne pouvait que séduire le banquier Laborde qui, plus riche que jamais, est alors au faîte de sa puissance.
« Chaque élément topographique a été soigneusement pensé et la nature entièrement raisonnée afin d’offrir au promeneur la vision idéale d’un Eden aux vues inspirantes. »
C’est l’architecte François-Joseph Bélanger, fameux pour avoir fait sortir de terre en soixante-quatre jours seulement la folie de Bagatelle pour le comte d’Artois, qui sera d’abord chargé des travaux et aménagements du parc. Il en concevra le plan général, avant d’être remercié un an plus tard en 1786 par son commanditaire, vraisemblablement agacé par son entêtement à décider seul tout autant que par le manque de clarté de ses comptes. Trois semaines après son renvoi, c’est celui que l’on surnomme le « poète du temps », Hubert Robert, qui le remplace. Sans trahir son prédécesseur, il a pour objectif de poursuivre les travaux « dans le style le plus grand, le plus simple et le plus noble ». Sept années seront encore nécessaires avant de finaliser un chef-d’œuvre né à la frontière entre les idéaux des Lumières et le préromantisme, où chaque élément topographique a été soigneusement pensé et la nature entièrement raisonnée afin d’offrir au promeneur la vision idéale d’un Eden aux vues inspirantes.

La famille de Saint-Léon réunit dans son domaine d’autres éléments parfois promis à la destruction, comme le fronton sculpté de l’aile gauche du château de Saint-Cloud
Qu’est-ce qu’une fabrique ?
Constructions pittoresques dont la vogue triompha au XVIIIe siècle, les fabriques étaient conçues afin de ponctuer le parcours du promeneur au sein d’un jardin paysager en favorisant par leur esthétique la méditation, voire une réflexion sur le passage du temps. Il est possible de les regrouper principalement en quatre typologies : les fabriques classiques, inspirées par l’Antiquité (temple, colonnade), les fabriques exotiques, évocatrices de contrées lointaines (pyramide, pagode), les fabriques naturelles (grotte, cascade) et enfin les fabriques champêtres, reproduisant une architecture vernaculaire, à l’image du Hameau de la Reine au Petit Trianon.

François Joseph Bélanger, Projet d'élévation pour le moulin de Méréville, vers 1755-1818. Crayon, encre noire et aquarelle sur papier vergé, 34,5 x 54,1 cm. New York, Metropolitan Museum of Art. © akg-images
Un décor proprice à la méditation
Alors que brillent les derniers feux de l’Ancien Régime, Méréville jouit incontestablement d’une position éminente parmi ses pairs, tant par sa taille (90 hectares) que par le nombre de curiosités qu’il propose : trente-deux pièces d’eau, neuf îles, vingt-deux ponts, sans compter les dizaines d’allées, cascades et grottes et la vingtaine de fabriques qui rythme le parcours. Conçue comme une promenade initiatique, la visite propose en effet un certain nombre de bâtiments pittoresques dont la découverte invite à la méditation. C’est notamment le cas de la spectaculaire « colonne trajane », véritable phare dominant le domaine du haut de ses 35 mètres qui affirme par sa position éminente l’ambition immense du marquis de Laborde. Plus loin, le visiteur découvrira près du pont de roche une petite grotte tapissée de cristaux bleutés, un moulin, un pont chinois orné de boules en cuivre doré, une colonne rostrale, un mémorial consacré au capitaine Cook, ou encore un temple dédié à la Piété filiale. « M. de Laborde a fait exécuter ici un jardin anglais sans contredit un des plus curieux qu’on puisse imaginer. D’ailleurs il n’y avait qu’un pareil Crésus capable d’y suffire », note alors le prince de Ligne dans ses Mémoires secrets. La lame de la guillotine viendra en 1794 briser le destin du marquis de Laborde. Méréville est ensuite occupé par sa veuve avant d’être vendu à plusieurs reprises dans le courant du XIXe siècle. Trop lourd à gérer pour ses différents propriétaires, le domaine est peu à peu négligé, voire dépecé. En 1895, Alexandre-Henri Dufresne, comte de Saint-Léon, fait l’acquisition des quatre plus importantes fabriques de Méréville, déjà largement dégradées, auprès du marchand de bois Carpentier désormais propriétaire du domaine, les sauvant ainsi de la destruction. Il les fait installer dans le parc de son château de Jeurre qui se trouve à quelques kilomètres de là.

Hubert Robert (1733-1808), Le château de Méréville. Huile sur toile. Sceaux, musée du domaine départemental de Sceaux. © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
Les fabriques de Méréville
En 1895, le comte de Saint-Léon sauve de la destruction les quatre plus importantes fabriques de Méréville et les fait installer dans le parc du château de Jeurre.
La colonne rostrale
Conçue par Bélanger et modifiée par Hubert Robert, cette colonne en marbre bleu turquin arborant des rostres de navire en bronze doré est commandée par Laborde à la gloire de ses deux fils partis de Brest le 1er août 1785 afin d’accompagner La Pérouse dans son expédition. Ces derniers périrent en mer avant l’installation de la colonne en 1788.

La colonne rostrale. © Actu-culture.com / O.P.-M.
Le cénotaphe de Cook
Dessiné par Hubert Robert en 1786 et réalisé en 1788, ce cénotaphe dédié à la mémoire du navigateur anglais mort en 1779 s’inspire manifestement de la fontaine de Commode à Rome que l’artiste avait jadis pu admirer. Il est composé de quatre colonnes doriques sans base encadrant un sarcophage de marbre blanc sur lequel repose une urne funéraire. Le sculpteur Augustin Pajou est l’auteur du buste de Cook qui en orne l’une des faces.

Le cénotaphe de Cook. © Actu-culture.com / O.P.-M.
Le temple de la Piété filiale
Inspirée par le temple de Vesta à Tivoli, cette fabrique grandiose composée d’une salle circulaire entourée par dix-huit colonnes corinthiennes que surmonte une coupole à caissons percée d’un oculus tire son nom de la statue de la Piété filiale que Pajou avait représentée sous les traits de la fille du banquier, Nathalie. Aujourd’hui conservée dans une collection particulière, la sculpture originale a été remplacée au centre de l’édifice par une Vénus sortant du bain ciselée par un élève de l’école de sculpture de Canova.

Le temple de la Piété filiale au plan circulaire. © Actu-culture.com / O.P.-M.
La laiterie
Conçue par Hubert Robert en 1790 et achevée en 1792, elle avait pour ambition de rivaliser avec celle qu’il avait imaginée pour la reine à Rambouillet. Seule la façade de cette ultime fabrique conçue par l’artiste est aujourd’hui visible à Jeurre, mur plat doté d’un fronton dont se détachent six colonnes ioniques soutenant une demi-coupole. Les vestiges de la salle de marbre et de la grotte à laquelle il donnait accès sont toujours visibles à Méréville. Derrière ce décor ont été remontés deux bas-reliefs provenant du château de Saint-Cloud.

Vue extérieure de la laiterie de Rambouillet. © Actu-culture.com / O.P.-M.
Les Saint-Léon au chevet du patrimoine en péril
Construit à la fin du XVIIe siècle par la famille Regnault de Barre, le château de Jeurre est acheté un siècle plus tard par le financier Louis César Alexandre Dufresne de Saint-Léon (1752-1836). Menacé par le tribunal révolutionnaire, il émigre, laissant le domaine aux mains de sa filleule. Elle épousera le comte Mollien, puissant ministre du Trésor public sous l’Empire qui, de 1809 à 1813, fera agrandir le château par les architectes Pierre-Nicolas Bénard et Jacques-Charles Bonnard. C’est à eux que l’on doit la construction du pigeonnier et des communs dans un style « retour d’Italie » qui s’inspire des fermes du Piémont. Grand Prix de Rome de sculpture, Alexandre-Henri Dufresne, comte de Saint-Léon (1820-1903) rachète dans la deuxième moitié du XIXe siècle le château qui appartint à son grand-oncle et fait l’acquisition des fabriques dans le cadre de sa politique d’embellissement du domaine. Démontées, elles sont ensuite numérotées pierre par pierre avant d’être à nouveau assemblées, un travail de titan qui durera plus de dix ans. La colonne rostrale, le temple de la Piété filiale, le cénotaphe de Cook et la façade de la laiterie retrouvent ainsi à Jeurre un nouvel écrin à leur mesure. Ce goût pour le patrimoine en péril poussera la famille de Saint-Léon à réunir dans son domaine d’autres éléments parfois promis à la destruction. Elle fait ainsi l’acquisition d’une sphère armillaire du XVIIe siècle, du fronton sculpté de l’aile gauche du château de Saint-Cloud, du portail XVIIIe de l’hôtel de la comtesse de Verrue ainsi que de fragments d’édifices parisiens, à l’image de l’avant-corps sculpté par Coysevox de l’hôtel d’Anglade que l’on démolit rue des Archives et qui a été remonté au centre de la façade ouest du château devant le miroir d’eau. Au XXe siècle, c’est au paysagiste Achille Duchêne que l’on fait appel afin d’organiser les monuments au sein de l’immense parc à l’anglaise de 60 hectares du domaine. Demeuré dans la même famille depuis le XIXe siècle, le domaine de Jeurre appartient aujourd’hui à la comtesse de Saint-Léon à la suite du décès de son époux survenu il y a quelques années. Une longue campagne de travaux est actuellement envisagée afin d’ouvrir plus largement le site au public et de rendre à ce lieu où tout n’est qu’ordre et beauté son lustre passé.

Le portail XVIIIᵉ de l’hôtel de la comtesse de Verrue. © Actu-culture.com / O.P.-M.
Promenade en Sud-Essonne
Le château de Jeurre se situe au cœur d’un département riche en trésors architecturaux. Voici quelques lieux incontournables à proximité qui permettent de prolonger la visite. Mais attention, la plupart d’entre eux ne sont ouverts que le week-end.
Par Enzo Menuge
Maison de Jean Cocteau
« C’est à Milly-la-Forêt que j’ai découvert la chose la plus rare du monde, un cadre » a déclaré Jean Cocteau. C’est dans cette belle demeure du XVIIIe siècle, bordée par la rivière l’École, que l’artiste trouvait un refuge loin des mondanités parisiennes. Acquise en 1947 avec Jean Marais, il y séjourna régulièrement avec ses amis et notamment avec Édouard Dermit, son dernier compagnon et légataire universel. Il y est mort en 1963 et est enterré dans la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, qu’il avait lui-même décorée en 1959. Devenue la propriété de Pierre Bergé qui l’ouvrit à la visite, elle fut fermée après le décès de celui-ci en 2017. Reprise par la région Ile-de-France, elle a rouvert le 1er juin dernier après avoir été réaménagée et accueille jusqu’au 3 novembre 2019 une belle exposition sur les dessins du poète.

La maison Jean Cocteau. © CDT 91
Maison Jean Cocteau, 15 rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt. Tél. 01 64 98 11 50. www.maisonjeancocteau.com
Le Cyclop
Au milieu d’une clairière de la forêt de Milly se dresse une imposante tête de 22,5 mètres de haut et de 350 tonnes d’acier ! Étincelant de miroirs, le Cyclop veille de son unique œil sur les alentours. Cette construction hors norme est le résultat du rêve fou de Jean Tinguely, de Niki de Saint Phalle et de leurs amis du Nouveau Réalisme. Fruit de 25 ans de labeur, l’ouvrage réunit des accumulations d’Arman, des compressions de César, un tableau-piège de Spoerri, un pénétrable de Soto et bien d’autres œuvres surprenantes.

Le Cyclop. H. 22,5 m. © CDT 91
Le Cyclop de Jean Tinguely, Prolongement du 66 rue Pasteur (côté bois), 91490 Milly-la-Forêt. Tél. 01 64 98 95 18. www.lecyclop.com
Château du Marais
En 1772, Jean Le Maître, trésorier général de l’artillerie et du génie, décide de raser le château-fort des Hurault pour faire construire par l’architecte Jean-Benoît-Vincent Barré l’actuelle demeure. Le portique dorique et l’équilibre subtil de ses proportions font de ce château un des plus beaux exemples d’architecture néoclassique du règne de Louis XVI. En 1899, la duchesse de Talleyrand l’acquiert par l’intermédiaire de la duchesse de Noailles et y commence d’importants travaux de restauration qui seront poursuivis par sa fille Violette de Talleyrand, épouse de Gaston Palewski, ministre d’état sous le général de Gaulle.

Vue extérieure du château du Marais. © CDT 91
Château du Marais, 21 rue du Marais, 91530 Le Val-Saint-Germain. Tél. 01 64 58 91 60. www.chateaudumarais.com
Château de Courances
Au sortir de Milly-la-Forêt, se trouve le magnifique château de Courances. Construit au XVIIe siècle, la demeure connut une période d’abandon au XIXe siècle avant d’être remaniée par le baron Samuel de Haber qui la dota de ses briques rouges et de son escalier en fer à cheval, copié sur celui de Fontainebleau. Le domaine s’étend sur 75 hectares de parc où se déploient pièces d’eau, parterres à la française et un remarquable jardin japonais.

Vue extérieure du château de Courances. © CDT 91
Château de Courances, 13 rue du château, 91490 Courances. Tél. 01 60 78 01 25. www.domainedecourances.com
Domaine de Méréville
Niché dans l’ancien pays de Beauce, le domaine de Méréville est le dernier exemple de jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle. Grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde s’est entouré des plus prestigieux artistes de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour concevoir ce jardin paysager anglo-chinois. Lorsqu’il acquiert le domaine en 1784, le marquis ne conserve pas le jardin à la française, effaçant ses allées rectilignes au profit de petits chemins sinueux. Il dote les coteaux abrupts du plateau qui entoure le jardin de grottes et d’enrochements dans lesquels il fait bon se rafraîchir l’été. Il détourne la Juine qui coule au fond du parc pour créer des méandres, des lacs et de petites îles. Aux antipodes de la nature domptée et domestiquée des jardins du XVIIe siècle, le parc de Méréville est caractéristique de la nouvelle sensibilité qui se développe au XVIIIe siècle autour du Sublime. Une grande partie des fabriques qui l’ornaient ont été transportées dans le parc du château de Jeurre. Depuis le mois de décembre 2000, le château et le parc sont la propriété du conseil départemental de l’Essonne.

Vue extérieure du château de Méréville. © CDT 91
Château de Méréville, 2 avenue du Général de Gaulle, 91660 Méréville. Tél. 01 69 78 36 87. www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme
Église de Saint-Sulpice-de-Favières
Le voyageur qui découvre au milieu de la vallée de l’Orge le village de Saint-Sulpice-de-Favières est interpellé par la disproportion entre la petite taille du bourg et les imposantes dimensions de son église. Lieu de guérison miraculeuse, Saint-Sulpice devient au XIIIe siècle sous l’impulsion de Saint Louis, l’un des plus importants pèlerinages du diocèse de Paris. Édifiée pendant les dernières années de son règne, l’église reste en grande partie inachevée à la fin du XIIIe siècle, mais elle constitue, avec son chœur lumineux culminant à 22 mètres, un des plus beaux exemples de gothique rayonnant dans la région.

Église de Saint-Sulpice-de-Favières. © CDT 91
1 rue aux Fèves, 91910 Saint-Sulpice-de-Favières.
Château de Chamarande
Propriété du conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Chamarande accueille sur ses 98 hectares un important centre d’art contemporain et les archives du département. Dès le XVIe siècle un hôtel seigneurial y est bâti par un ami d’Henri IV, François Miron. Ravagé par la Fronde, il est vendu en 1654 à Pierre Mérault, écuyer et secrétaire du Roi-Soleil, qui fait édifier le château actuel dans le plus pur style Louis XIII. Endetté, Mérault vend la propriété en 1684 à Clair Gilbert d’Ornaison, premier valet de chambre de Louis XIV, dit « Chamarande », qui donnera ce nom au domaine.

Vue extérieure du château de Chamarande. © CDT 91
Domaine départemental de Chamarande, 38 rue commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande. Tél.01 60 82 52 01. chamarande.essonne.fr
Parc et château de Jeurre, 91150 Morigny-Champigny. Ouvert à la visite du 1er juin au 31 août et toute l’année sur demande pour des groupes supérieurs à 12 personnes. Tél. 01 64 94 57 43. www.parcdejeurre.fr
À lire : François d’Ormesson et Jean-Pierre Thomas, Jean-Joseph de Laborde, banquier de Louis XV, mécène des Lumières, Perrin, 2002, 380 p.
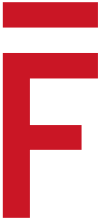
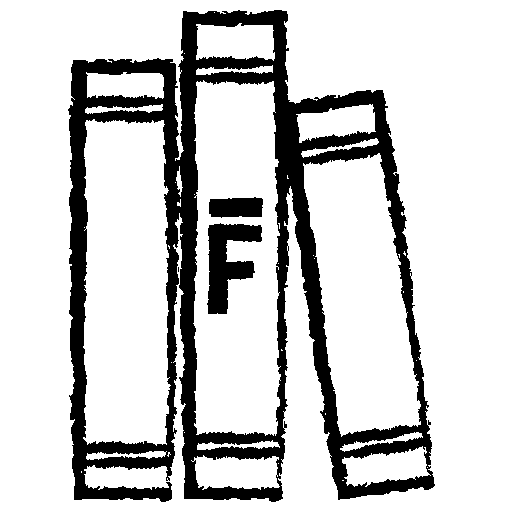
d’expertise éditoriale
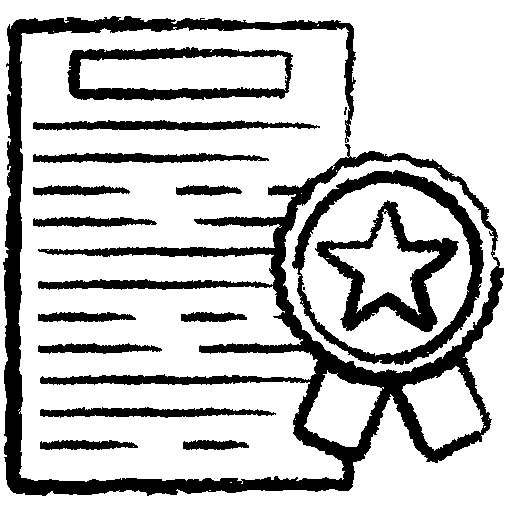
et fiabilité
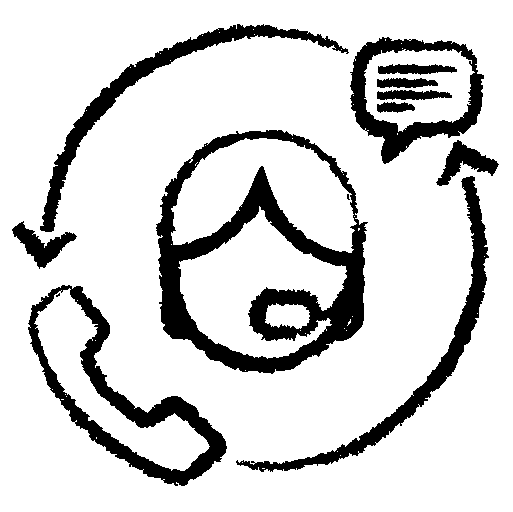
à l’écoute
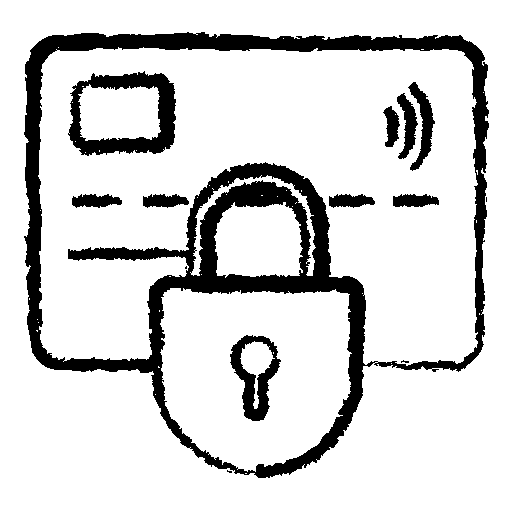
100% sécurisé