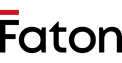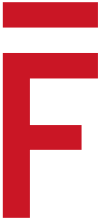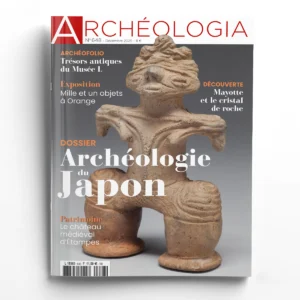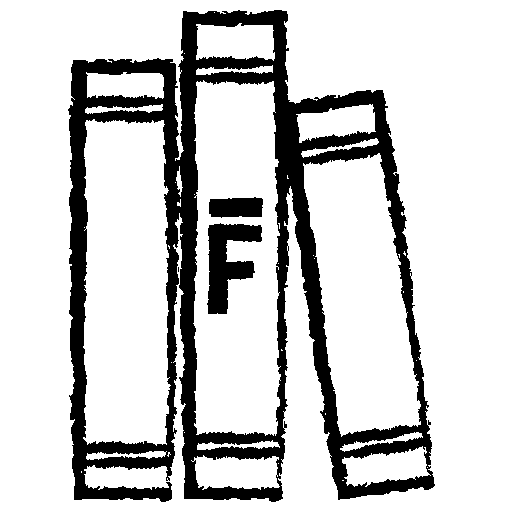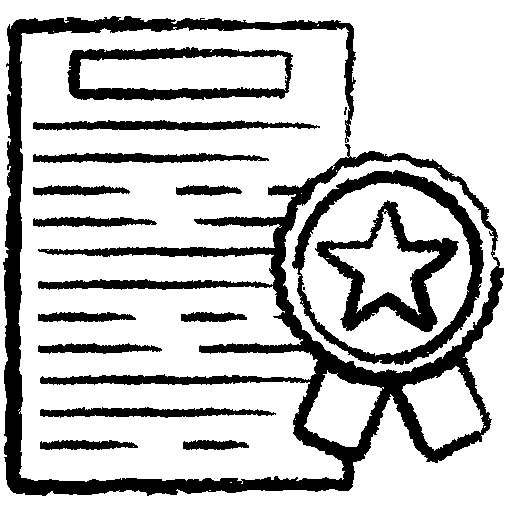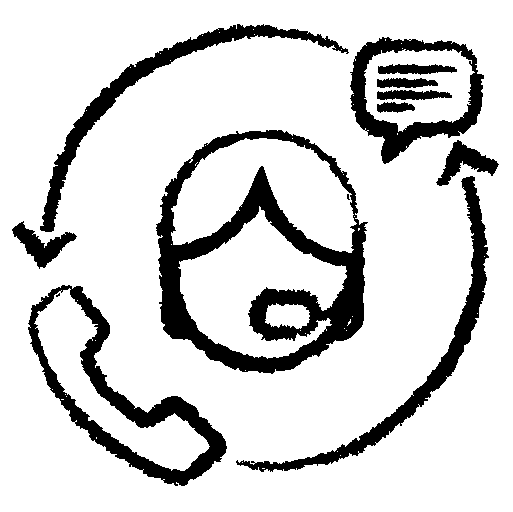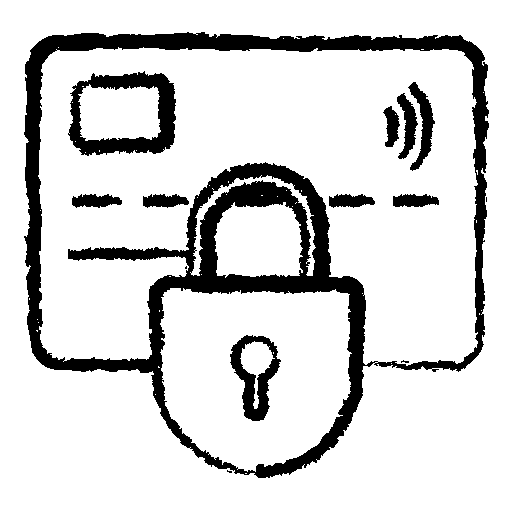À quand remonte la dernière grande exposition consacrée à Greuze ?
À 1976 ! Elle avait été organisée par l’Américain Edgar Munhall, grand spécialiste du peintre, et présentée dans deux musées aux États-Unis, puis au musée des Beaux-Arts de Dijon. En 2005, j’ai monté une exposition autour de l’affaire du « Septime Sévère » à l’occasion du bicentenaire de la mort du peintre, car le musée Greuze de Tournus (ville natale du peintre) avait acheté l’esquisse préparatoire de ce tableau. Mais aucune exposition monographique d’ampleur n’avait jusque-là été consacrée à l’artiste à Paris, alors que c’est dans cette ville qu’il fut acclamé par le public, adulé par les critiques et recherché des plus importants collectionneurs ! Il était grand temps de lui rendre justice…

Annick Lemoine, directrice du Petit Palais © D.R.
Comment expliquez-vous le désamour dont le peintre a été l’objet en France ?
Je crois que l’artiste a pâti de son immense succès. Des imitations de qualité médiocre ont circulé et ont contribué à donner une vision désuète et faussée de son art. Il manquait par ailleurs au public les clés pour comprendre la véritable portée de son œuvre. Avec les deux autres commissaires, Yuriko Jackall (en charge des peintures au Detroit Institute of Arts) et Mickaël Szanto (maître de conférences à la Sorbonne), nous avons voulu relever ce défi : réhabiliter l’artiste et mettre en lumière sa modernité insoupçonnée.
« Greuze se fait l’écho de grands débats de société qui animent Paris au XVIIIe siècle, en particulier sur le statut de l’enfance. »
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), La malédiction paternelle. Le Fils ingrat, 1777. Huile sur toile, 130 x 162 cm. Paris, musée du Louvre. Photo service de presse. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michel Urtado
Regarder son œuvre à travers le prisme de l’enfance, fil rouge de l’exposition, permet de battre en brèche les idées reçues sur l’artiste ?
Oui, je le pense. Ce prisme permet de montrer à la fois la virtuosité technique de l’artiste, sa capacité à traduire la diversité des émotions enfantines et son adhésion aux idées les plus novatrices de son temps. À travers ses portraits d’enfants et ses scènes de genre autour de la famille, Greuze se fait l’écho de grands débats de société qui animent Paris au XVIIIe siècle, en particulier sur le statut de l’enfance. Il montre qu’elle n’est plus une étape de la vie sans intérêt, mais un âge à part entière, avec ses caractéristiques et ses besoins spécifiques. Il prône par exemple l’allaitement maternel, plutôt que la mise en nourrice – très largement répandue à l’époque – qui conduisait au décès de nombreux nouveaux-nés.
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Jeune bergère effeuillant une marguerite, dit La Simplicité, 1759. Huile sur toile, 71,1 x 59,7 cm. Fort Worth, Kimbell Art Museum. Photo service de presse. © Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas
Peut-on le qualifier d’homme des Lumières ? Que sait-on de ses lectures, des salons qu’il fréquentait ?
Oui, c’est un homme nourri des idéaux des Lumières. Il croit aux vertus de l’éducation et a la conviction que les parents ont un rôle crucial à jouer dans le développement des enfants, dans la construction de leur personnalité et de leur esprit critique. De toute évidence, il a consulté l’Encyclopédie de d’Alembert et de son ami Diderot, sans doute aussi lu l’Émile de Rousseau. On sait qu’il fréquentait le salon de Madame Geoffrin, une femme de lettres ouverte aux idées des Lumières. Enfin, c’était un franc-maçon, qui appartenait à la loge des Neuf Sœurs, où se réunissaient savants, penseurs et artistes éclairés.

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Un enfant qui s’est endormi sur son livre, dit Le Petit Paresseux, 1755. Huile sur toile, 65 x 54,5 cm. Montpellier, musée Fabre. Photo service de presse. © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / Photo Frédéric Jaulmes
L’exposition tire un autre fil, celui du « Greuze intime », en évoquant son couple haut en couleur et son tempérament bien trempé. Une façon de le rendre plus proche du public d’aujourd’hui ?
Oui, et de mieux faire comprendre qui était Greuze : un esprit frondeur, qui s’autorisait toutes les libertés. Il ose faire patienter l’Académie royale de peinture et de sculpture treize ans avant d’envoyer son morceau de réception, L’Empereur Septime Sévère reproche à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner (1769). Un retard unique dans l’histoire de l’institution ! Et dans un autre registre, en 1761, il refuse de peindre le portrait de la Dauphine, la belle-fille du roi, sous prétexte qu’il n’a pas pour habitude de peindre des « visages plâtrés ». Sa réponse, considérée comme une insulte, fait scandale à la cour !

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), L’Empereur Septime Sévère reproche à son fils Caracalla d’avoir voulu l’assassiner, 1769. Huile sur toile, 124 x 160 cm. Paris, musée du Louvre. Photo service de presse. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / photo Michel Urtado
Vous évoquiez les « clés de lecture » de son œuvre. Quels messages délivrent ses scènes de genre autour de la famille ?
L’artiste nous convie à pénétrer au cœur de l’intimité des familles et de ses désordres inavoués. Chez lui, le foyer n’est pas uniquement un havre de paix, c’est aussi un lieu de violence physique et de cruauté psychologique. Et les victimes en sont bien plus les enfants que les adultes ! La Femme en colère (vers 1785), par exemple, figure une terrible dispute entre un mari et sa femme, en présence de leurs filles – allusion probable aux déboires conjugaux du peintre. Dans La Présentation de l’enfant naturel (vers 1770), un dessin d’une liberté d’exécution extraordinaire, l’artiste représente vraisemblablement les réactions d’effroi et d’hostilité suscitées par un enfant né hors-mariage. Sa sympathie pour le petit personnage, abandonné et vulnérable, transparaît avec évidence.

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), La Présentation de l’enfant naturel, vers 1770. Plume et encre brune, pinceau et lavis gris et brun sur craie noire, 33 x 50,8 cm. New York, TheMetropolitan Museum of Art. Photo service de presse. © GrandPalaisRmn (The Metropolitan Museum of Art) / Image of the MMA
« La notion de séduction, synonyme de piège, traverse son œuvre. »
N’y a-t-il pas la tentation d’interpréter son œuvre avec notre sensibilité d’aujourd’hui ?
Certaines peintures jouent sur l’ambiguïté et peuvent être lues de différentes façons. Pour y voir plus clair, nous avons confronté ces tableaux avec leurs dessins préparatoires. Le dessin occupe une place centrale chez Greuze et permet de mieux comprendre ses intentions. Dans L’Oiseleur, magnifique prêt du musée de Varsovie, le jeune homme qui accorde sa guitare est un chasseur d’oiseaux. Or Greuze associe régulièrement les femmes aux oiseaux. La notion de séduction, synonyme de piège, traverse son œuvre. En regardant plus attentivement cette toile, on relève plusieurs indices troublants : le regard féroce de l’homme, les oiseaux inertes… Le dessin préparatoire vient confirmer cette lecture, car l’oiseleur y apparaît encore plus menaçant : Greuze brosse en creux le portrait d’un prédateur sexuel.

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), L’Oiseleur accordant sa guitare, 1757. Huile sur toile, 62 x 48 cm. Varsovie, National Museum. Photo service de presse. © Varsovie National Museum / photo Krzysztof Wilczyński
Autre œuvre ambiguë, La Cruche cassée… Comment interprétez-vous ce tableau du Louvre ?
Je pense que cette peinture n’évoque pas simplement une jeune fille qui a perdu sa virginité. Il s’y déroule un drame sous-jacent, que le dessin préparatoire représente de manière plus évidente. Le regard vide – voire terrifié – de la jeune fille et le tumulte des drapés indiquent une agression, vraisemblablement un viol. Tout au long de sa carrière, le peintre interroge le basculement dans l’âge adulte, l’éveil à l’amour mais aussi le danger des prédateurs, jeunes ou vieux. Dans le Paris du XVIIIe siècle, celui du moins de la richesse, des amateurs d’art et des grands seigneurs, Greuze invite à voir ce qu’il est plus commode d’ignorer. En cela, il est un artiste « engagé », pour utiliser un terme très actuel.

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), La Cruche cassée, 1771-1772. Huile sur toile, 109 x 87 cm. Paris, musée du Louvre. Photo service de presse. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Angèle Dequier
Parmi les sources d’inspiration du peintre figurent Chardin et les maîtres hollandais du XVIIe. Aurait-il été intéressant de proposer des confrontations ?
Nous avons choisi de nous concentrer sur Greuze, car il n’avait jamais fait l’objet d’une exposition d’envergure à Paris, et essayé de réunir le plus grand nombre possible d’œuvres de sa main. Nous avons eu la joie d’obtenir des prêts exceptionnels, venus du musée du Louvre, du musée Fabre (Montpellier), du Metropolitan Museum of Art (New York), du Rijksmuseum (Amsterdam), du Kimbell Art Museum (Fort Worth), des Galeries nationales d’Écosse (Édimbourg), des collections royales d’Angleterre et de nombreuses collections particulières.
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Jeune berger qui tente le sort pour savoir s’il est aimé de sa bergère, 1760-1761. Huile sur toile, 72,5 x 59,5 cm. Paris, Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Photo CC0 Paris Musées / Petit Palais
L’exposition a-t-elle permis de découvrir de nouvelles œuvres ?
Oui, plusieurs. Une Enfant qui joue avec un chien, un tableau que l’on croyait perdu, a été retrouvé dans un château en Angleterre ! Au Salon de 1769, cette toile qui représente probablement Louise-Gabrielle, la fille cadette de Greuze, est considérée comme le chef-d’œuvre du peintre. Autre découverte : une nouvelle version peinte de L’Oiseau mort, apparue récemment sur le marché de l’art et prêtée par un collectionneur.

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Une Enfant qui joue avec un chien (portrait de Louise-Gabrielle Greuze), 1767. Huile sur toile, 62,9 x 52,7 cm. Angleterre, collection particulière. Photo service de presse. © collection particulière
Pour l’instant, le public est-il au rendez-vous ?
L’exposition a ouvert le 16 septembre, et d’ores et déjà, son succès dépasse toutes nos attentes ! Elle s’inscrit dans une politique à laquelle je crois et pour laquelle je me bats : présenter de grands artistes oubliés ou peu connus du grand public, comme dernièrement Jusepe de Ribera ou Théodore Rousseau. En 2024, la fréquentation du Petit Palais a battu tous les records. Cela prouve que l’art ancien trouve son public et mérite des expositions ambitieuses !
Greuze en 8 dates
1725 Naissance à Tournus, en Bourgogne.
1750 Il s’installe à Paris et se fait rapidement une spécialité des figures d’enfants.
1755-1757 Séjour en Italie.
1759 Mariage avec Anne Gabrielle Babuty, fille d’un libraire parisien.
1761 Il suscite l’engouement du public et de la critique avec L’Accordée de village.
1769 Greuze est élu à l’Académie comme peintre de genre et non pas peintre d’histoire, comme il l’espérait.
1793 Divorce. Les deux filles du couple restent auprès de leur père.
1805 Il meurt à Paris, complètement ruiné.
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Autoportrait, vers 1760. Huile sur bois, 65 x 51,5 cm. Paris, musée du Louvre. Photo service de presse. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Thierry Le Mage
« Jean-Baptiste Greuze. L’enfance en lumière », jusqu’au 25 janvier 2026 au Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, avenue Winston Churchill, 75008 Paris. Tél. 01 53 43 40 00. www.petitpalais.paris.fr
À lire : Catalogue, Paris Musées, 392 p., 49 €.