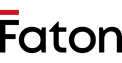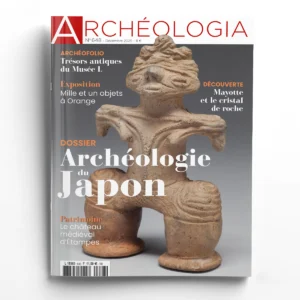Grandes questions de l’archéologie : « Pourquoi et comment détruire le patrimoine »

Ainsi, l’ignorance a longtemps caractérisé les pouvoirs publics français face à la destruction du patrimoine archéologique tout au long des Trente Glorieuses. Mais cette ignorance, face à ce qui était irrémédiablement détruit lors des grands travaux d’aménagement – un site important sous chaque kilomètre d’autoroute en moyenne –, reposait aussi sur le mépris des décideurs politiques et économiques quant au passé autochtone, visiblement de peu de poids face à l’abondance des statues et autres objets précieux venus de l’Orient, de la Grèce ou de Rome qui s’accumulaient dans le grand musée du Louvre.
Destructions pacifiques…
Cette indifférence n’était pas nouvelle, puisque Victor Hugo déjà, dans son célèbre pamphlet Guerre aux démolisseurs, s’indignait en 1825 des destructions systématiques de monuments et de remparts médiévaux, censées permettre le nouvel urbanisme triomphant de la révolution industrielle en marche. Depuis la Renaissance, on qualifiait d’ailleurs avec mépris de « gothique », c’est-à-dire d’art des Barbares goths, l’architecture du second Moyen Âge. Les sociétés médiévales n’avaient elles-mêmes guère fait mieux, en transformant en carrières de pierre ou de chaux les monuments de l’Antiquité, quand elles ne les avaient pas recyclés en églises – comme la Maison carrée de Nîmes –, ou en citadelles de fortune, comme les « arènes » (amphithéâtre) d’Arles, dotées de solides tours défensives et hérissées de bâtiments d’habitation. Le même constat s’imposerait sans peine dans bien d’autres pays, quel qu’en soit le contexte historique.

La Maison carrée à Nîmes. © Krzysztof Golik / CC BY SA
… ou militaires
Face à ces destructions sereines de temps de paix, se distinguent les saccages dus aux conflits armés, ce dont notre actualité abonde sinistrement. L’ancien directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, avait d’ailleurs remis en 2015, à la demande du président de la République, un rapport sur la protection du patrimoine en situation de conflit armé, contenant Cinquante propositions françaises pour protéger le patrimoine de l’humanité (voir aussi Archéologia, no 540, février 2016, p. 12-13). Autant dire qu’il n’a guère été suivi d’effets lors des conflits et massacres divers qui ont fait la une tout au long de la décennie qui suivit. Comme l’observait le rapport, ce ne sont pourtant pas les conventions internationales qui manquent, au nombre d’une bonne dizaine, de celle de 1954 « pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé » précisée en 1999 par un « protocole » (que la France n’a toujours pas ratifié) à la convention UNESCO de 1995 dite Unidroit sur « les biens culturels volés ou illicitement exportés » adoptée à Rome le 24 juin 1995 (signée, mais non ratifiée par la France). Ce peu d’intérêt des États pour cette question cruciale avait d’ailleurs incité le rapport Martinez à « lancer un appel solennel à la ratification universelle des conventions protégeant le patrimoine » (mesure 7), voire d’élaborer une nouvelle convention (mesure 8) – préconisations restées évidemment lettre morte, tout comme l’idée, plus générale et régulièrement proposée, d’une convention internationale sur l’archéologie préventive, laquelle existe au niveau européen (c’est la convention dite de Malte ou de La Valette), mais nullement au niveau international de l’UNESCO.
Des monuments religieux particulièrement visés
Quant aux destructions violentes, elles peuvent tenir à des « dégâts collatéraux » : le monument patrimonial ou mémoriel n’était pas directement visé, mais il se trouvait dans une zone de combat. Ainsi, par exemple, des nombreuses églises ou cathédrales détruites par les bombardements alliés sur l’Allemagne. Mais il s’agit souvent d’actes délibérés, quels qu’en soient les objectifs. En France, les révolutionnaires de 1789 ont maintes fois démoli des monuments religieux puisque associés aux idéologies oppressives de l’Ancien Régime – s’attirant l’accusation, par l’abbé Grégoire, de « vandalisme », les malheureux Vandales de l’Antiquité tardive n’y étant pourtant pour rien. L’explosion à coups de canons par les talibans des célèbres bouddhas géants de Bâmiyân en Afghanistan en 2001 en est une manifestation comparable. Si les monuments religieux sont particulièrement visés, c’est parce qu’ils portent sur les croyances, noyaux durs de l’identité d’une société donnée, car seuls éléments consolateurs face à l’inexorable condition mortelle des êtres humains. De fait, les guerres de religion sont la plupart du temps les plus sanglantes et les plus impitoyables.

Vue de la falaise où les Bouddhas géants de Bâmiyân ont été sculptés. © Roland Lin / CC BY SA
Atteindre à l’identité des sociétés
Mais au-delà des croyances, c’est la mémoire d’une société que l’on cherche à détruire, notamment dans les atteintes aux cimetières, le respect dû aux morts étant l’un des principes les plus impératifs de nos sociétés. Ainsi, plus de deux mille cimetières juifs furent systématiquement vandalisés et rasés en Allemagne par le régime national-socialiste, pratique qu’il a étendue aux territoires provisoirement conquis, comme au cimetière juif de Thessalonique, à l’emplacement duquel se dresse désormais l’université de cette ville. De telles destructions délibérées se poursuivent encore sous nos yeux en divers lieux. Au-delà, ce peut être tout monument emblématique qui sera visé. Ainsi, durant la guerre civile en Bosnie, l’artillerie croate détruisit en 1993 le magnifique pont ottoman, édifié au XVIe siècle, de la ville musulmane de Mostar (most signifie pont en serbo-croate). Il fut reconstruit entre 2001 et 2004 sous l’égide de l’UNESCO et dans l’espoir de réconcilier les deux communautés. L’anéantissement par des membres d’Al-Qaïda des deux tours jumelles de New York lors des attentats-suicides du 11 septembre 2001 répondait évidemment à cette même préoccupation d’atteinte à l’identité d’une société.
Les vivants d’aujourd’hui sont les morts de demain
Pour revenir à l’archéologie préventive, qui s’efforce de conserver, sinon les vestiges eux-mêmes, du moins leur documentation, on entend parfois en France les élus locaux revendiquer qu’ils « s’occupent des vivants », tandis que les archéologues qui leur font face « ne se soucieraient que des morts ». Il y a au moins deux réponses à cette affirmation. La première est que, hélas, les « vivants » d’aujourd’hui seront les « morts » de demain. La seconde est que, même si le terme d’identité est parfois galvaudé, vivants et morts occupent un même territoire, un territoire que les vivants ont besoin de s’approprier pour y vivre pleinement, et que cette appropriation passe en particulier par la connaissance de son passé. Si chaque habitant actuellement vivant n’est pas nécessairement le descendant génétique direct des morts inhumés là, l’archéologie et l’histoire du territoire qu’il occupe sont des éléments essentiels de son propre rapport au monde. Et c’est bien à cela que portent atteintes les destructions, pacifiques ou violentes, par ignorance, indifférence ou délibérées, du patrimoine.
Pour aller plus loin
BOLIN A., 2023, Cultural Heritage and Armed Conflict: A Literature Review, Social Science Research Council.
CLACK T. & DUNCKLEY M. (dir.), 2023, Cultural Heritage in Modern Conflict: Past, Propaganda, Parade, Routledge.
DEMOULE J.-P. & SCHNAPP A., 2024, Qui a peur de l’archéologie. La France face à son passé, La Découverte.
HARRISON R. (dir.), 2020, Heritage Futures. Comparative approaches to natural and cultural heritage practices, UCL Press.
MAALOUF A., 1998, Les Identités meurtrières, Grasset.
MARTINEZ J.-L., 2015, Cinquante propositions françaises pour protéger le patrimoine de l’humanité, Rapport sur la protection du patrimoine en situation de conflit armé, remis au président de la République (en ligne).
MEDIAPART, Série plaidoyer pour l’archéologie. En ligne : www.mediapart.fr/journal/dossier/france/plaidoyer-pour-archeologie
MUNAWAR N. A. & SYMONDS J., 2023, « Empires of Lies? The Political Uses of Cultural Heritage in War », The Historic Environment: Policy and Practice, 14 (3), p. 308-325 (en ligne).



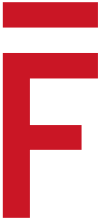
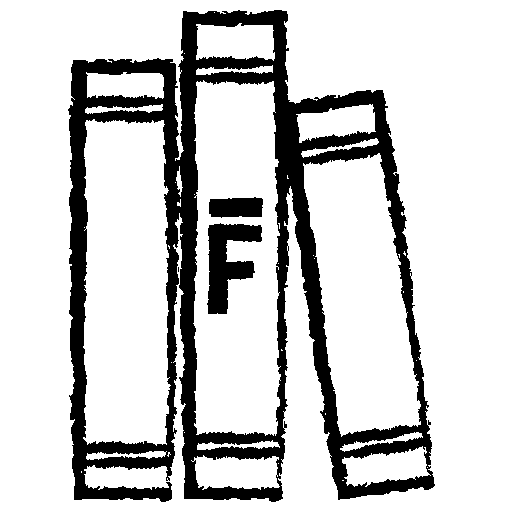
d’expertise éditoriale
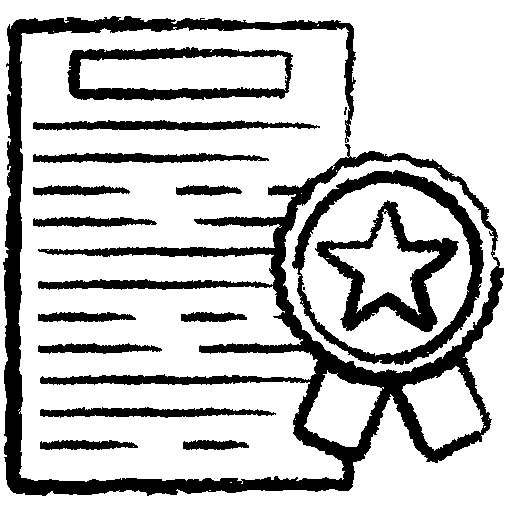
et fiabiltié
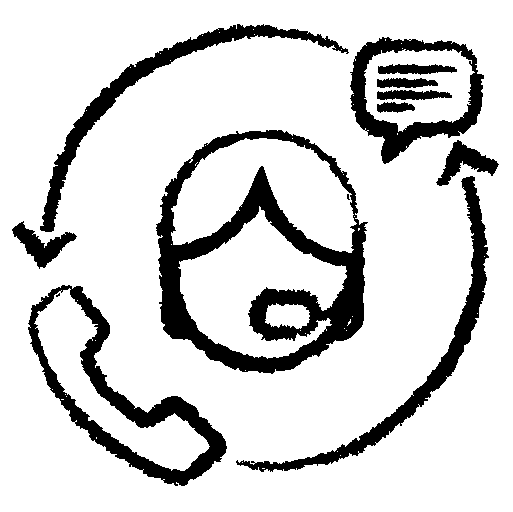
à l’écoute
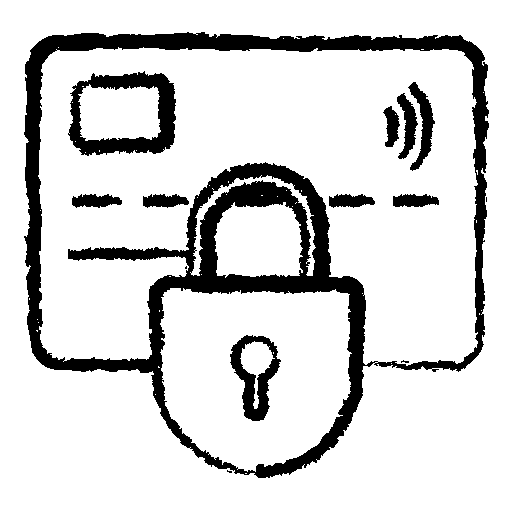
100% sécurisé