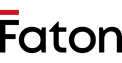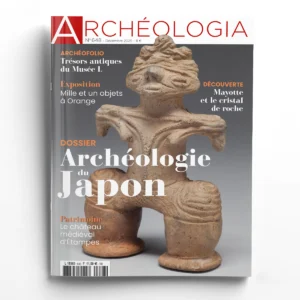Un étonnant tableau polisson des collections de Madame de Pompadour retourne à Versailles

Exécuté en 1728, le tableau est documenté trois ans plus tard dans le cabinet du conseiller d’État Louis Fagon, protecteur de Jean-Baptiste Oudry, en compagnie de plusieurs toiles de Coypel.
De Versailles à la Californie
La date de son entrée dans les collections de la favorite royale est inconnue : on retrouve sa trace en 1764, dans son inventaire après décès, parmi les œuvres de l’hôtel de Pompadour, actuel Palais de l’Élysée, rapportées du château de Versailles. Frère de la marquise, le marquis de Marigny hérite de la toile qu’il conservera toute sa vie. Elle réapparaît ensuite à plusieurs reprises sur le marché de l’art, jusqu’à son adjudication en 1999, chez Christie’s à Londres, pour £ 221 500. Le public avait pu l’admirer en 2016, à Lille, à l’occasion de l’exposition « Joie de vivre » ; elle était alors localisée dans une collection particulière californienne.

Charles-Antoine Coypel (1694-1752), Jeux d’enfants à la toilette (détail), 1728. Huile sur toile, 65,7 x 83,2 cm. Versailles, musée national du château de Versailles et de Trianon. Photo service de presse. © Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin
La coquetterie dans le boudoir
L’attrait de la marquise de Pompadour pour la représentation de l’enfance est bien connu : grande amatrice de l’œuvre de Greuze et de Drouais, elle conservait nombre de leurs toiles dans ses appartements. Si cette thématique est assurément au cœur du présent tableau, le message délivré est ici bien différent : loin d’exalter une tendre intimité, la toile déploie une partition parodique, flirtant avec la licence. Il ne s’agit pas de mettre en scène l’enfance, mais plutôt de singer le rituel de la toilette aristocratique en convoquant une ribambelle de putti.

Charles-Antoine Coypel (1694-1752), Jeux d’enfants à la toilette (détail), 1728. Huile sur toile, 65,7 x 83,2 cm. Versailles, musée national du château de Versailles et de Trianon. Photo service de presse. © Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin
Miroir, mouches et palette à fard
Trônant au centre de la composition, une enfant est l’objet de toutes les attentions. Contemplant son reflet dans le miroir, elle suit l’avancement de sa coiffure, alors qu’un émissaire s’apprête à lui remettre une missive. Le message est limpide : c’est assurément pour cet admirateur secret que la belle s’empresse. La dimension galante de la scène est renforcée par la présence incongrue de trois personnages masculins, largement dénudés, entourant la demoiselle : un homme de loi, un abbé de cour et un gentilhomme, dont l’anatomie est en partie masquée par une palette à fard. Poursuivant dans cette même veine, le premier plan du tableau se rit des excès de la mode : privé de jupon, le personnage de gauche expose impudiquement son intimité, tandis que celui de droite apparaît ridiculement vêtu d’un unique jupon. À proximité, une petite fille assise parodie la vogue des mouches en s’en recouvrant le visage.

Charles-Antoine Coypel (1694-1752), Jeux d’enfants à la toilette (détail), 1728. Huile sur toile, 65,7 x 83,2 cm. Versailles, musée national du château de Versailles et de Trianon. Photo service de presse. © Château de Versailles, Dist. RMN / Christophe Fouin
Une composition à succès
Ce sujet satirique semble avoir rencontré un succès immédiat. « De la mode, et de ses boutades, ce Jeû d’enfans rend les excès, ces Atours, malgré leur succès, sont bien souvent des mascarades », peut-on lire sur le cartouche de la gravure qu’en donnait, dès 1731, François-Bernard Lépicié (1698-1755). Vingt ans plus tard, on retrouve l’écho de cette version gravée en arrière-plan de La Serinette de Chardin, toile commandée au peintre par l’intermédiaire de Charles-Antoine Coypel. Une version plus importante du tableau (144 x 208 cm) est identifiée dans une collection particulière britannique, mais son caractère autographe est remis en cause par le spécialiste de l’artiste : le grand format se prête en effet fort peu à un sujet aussi licencieux…

François-Bernard Lépicié (1698-1755), d’après Charles-Antoine Coypel (1694-1752), Jeux d’enfants, 1731. Eau-forte et burin, 43,5 x 49,7 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. © The Metropolitan Museum of Art
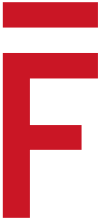
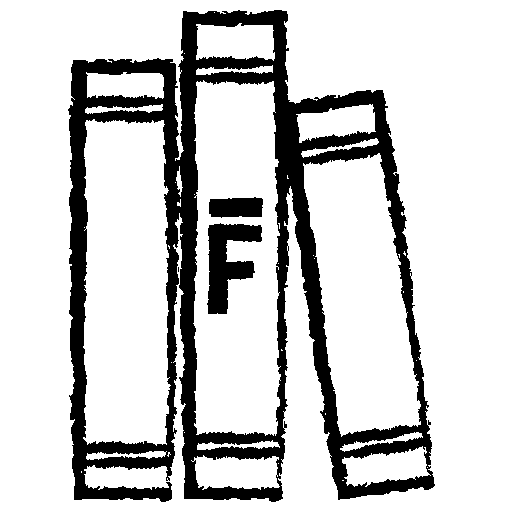
d’expertise éditoriale
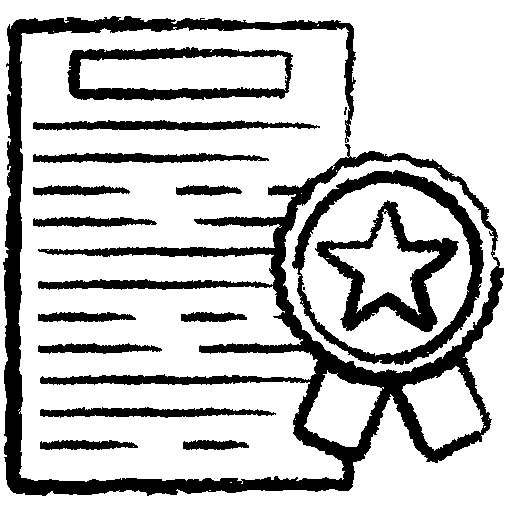
et fiabilité
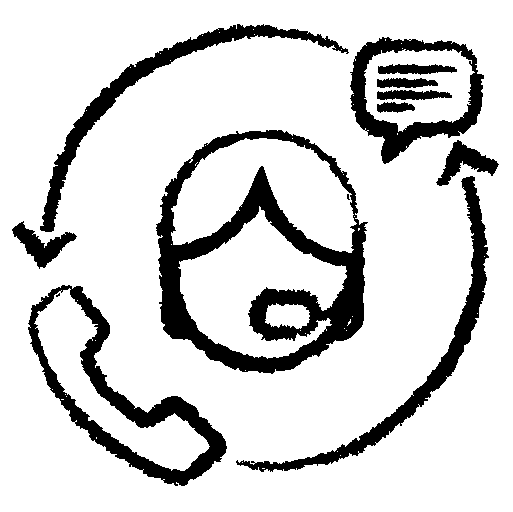
à l’écoute
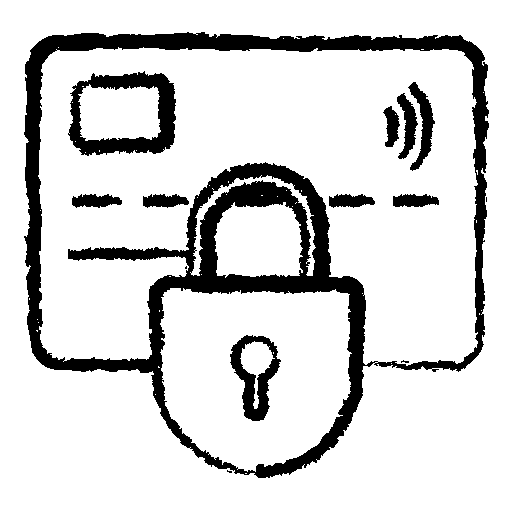
100% sécurisé