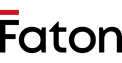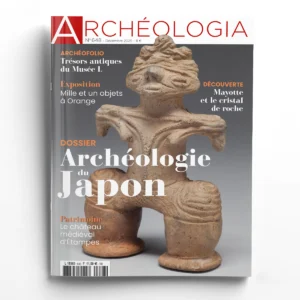Quand Nocret drapait les Bourbons d’or bleu

Réunissant 18 personnages grandeur nature sur 12 m2, La Famille royale dans l’Olympe est à la fois l’incontestable chef-d’œuvre de Jean Nocret (1615-1672) et le plus grand portrait français du XVIIe siècle parvenu jusqu’à nous. Alors que son écrin versaillais, l’antichambre de l’Œil-de-Bœuf jouxtant la chambre du Roi, fait l’objet jusqu’au printemps d’une campagne de restauration, cette toile spectaculaire vient de bénéficier d’une intervention fondamentale qui a révélé l’éclatant lapis-lazuli de cette apothéose des Bourbons.
Portrait de famille
Juché sur une estrade de marbre sous un baldaquin porté par deux atlantes, il trône en Apollon au cœur de la composition. Coiffé d’une couronne de lauriers et drapé d’or, le Roi-Soleil règne sans partage sur l’Olympe, au milieu de sa famille. Assise à ses pieds, la reine Marie-Thérèse (1638-1683) est représentée en Junon, entourée de trois de ses enfants : le Grand Dauphin (1661-1711) en Hyménée, Marie-Thérèse de France (1667-1672), dite la « Petite Madame », et Philippe-Charles de France (1668-1671), éphémère duc d’Anjou, en Cupidon. Derrière le monarque, la Grande Mademoiselle (1627-1693), cousine jadis frondeuse, est Diane, accompagnée de ses jeunes demi-sœurs évoquant les trois Grâces ; au centre du tableau, assurant le lien avec sa partie gauche, Anne d’Autriche (1601-1666), est dépeinte en Cybèle, la déesse mère. Mortes en bas âge, Anne-Élisabeth (1662) et Marie-Anne de France (1664), les deux premières filles du roi, sont figurées, comme le veut la tradition, dans un cadre formant tableau dans le tableau.
« … dans ce paysage d’Arcadie évoquant les fabuleux jardins de Saint-Cloud, Nocret met en scène le pouvoir et la pérennité des Bourbons, princes terrestres aux corps idéalisés élevés par la grâce du pinceau au rang des immortels. »
Véritable apothéose du mythe apollinien, cette toile immense est pour le visiteur d’aujourd’hui indissociable de l’esthétique versaillaise. C’est pourtant pour le château de Saint-Cloud, propriété de Monsieur, frère du roi, que fut livré par Jean Nocret, vers 1670, au soir de sa carrière, cet extraordinaire portrait de famille historié. Le prince s’y fait d’ailleurs représenter, à gauche de la composition, en Étoile du Point du Jour, annonciatrice du lever du Soleil : le message politique est limpide. À sa gauche, brille son épouse Henriette (1644-1670) en Flore, tandis qu’à sa droite trône sa belle-mère Henriette-Marie de France (1609-1669), fille d’Henri IV et reine douairière d’Angleterre figurée en Amphitrite. Un œil attentif notera sans doute que plusieurs personnages déjà disparus lors de l’exécution du tableau partagent pourtant ici la même réalité que les vivants, à l’image d’Anne d’Autriche, de la plus jeune demi-sœur de la Grande Mademoiselle, ainsi que de deux des enfants de Philippe d’Orléans, vraisemblablement évoqués au premier plan en angelots tenant la lyre d’Apollon. Certaines figures semblent par ailleurs avoir subi une véritable cure de jouvence, telle la reine douairière d’Angleterre, disparue en 1669 à presque soixante ans. Il ne s’agit assurément pas de proposer une image réaliste de la famille royale : dans ce paysage d’Arcadie évoquant les fabuleux jardins de Saint-Cloud, Nocret met en scène le pouvoir et la pérennité des Bourbons, princes terrestres aux corps idéalisés élevés par la grâce de son pinceau au rang des immortels.

Jean Nocret (1615-1672), La Famille royale dans l’Olympe (détail), vers 1670. Huile sur toile, 306 x 426,5 cm. Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Photo service de presse. © château de Versailles, dist. RMN / Christophe Fouin
Incohérences mythologiques
Les lecteurs d’Homère et Hésiode s’étonneront peut-être de ce que les liens familiaux entre les Bourbons ne correspondent ici en rien à ceux unissant les divinités mythologiques qu’ils incarnent. Apollon se retrouve marié à Junon, les Grâces et Diane ne forment qu’une seule et même sororie, tandis qu’Amphitrite est désignée mère de Flore ! La cohérence mythologique n’est cependant pas l’objectif recherché par Nocret : les dieux et déesses sélectionnées ne le sont que pour leurs qualités propres transmissibles à la personnalité représentée. Marie-Thérèse devait donc être Junon, épouse du dieu suprême, et Henriette-Marie de France, Amphitrite, afin de rappeler son statut de reine douairière d’une grande puissance maritime.
Au service de Son Altesse royale
Né à Nancy, le Lorrain Nocret est d’abord l’élève du peintre Jean Le Clerc (1586-1633) avant de passer 12 ans en Italie où il rencontre Poussin. À son retour, il devient en 1649 le peintre attitré du jeune frère du roi. Le château de Blois conserve ainsi un gracieux portrait du prince âgé d’une dizaine d’années, immortalisé par l’artiste en Bellérophon. Reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1663 avec une Repentance de Saint-Pierre, Nocret multiplie les projets, livrant de nombreuses effigies des membres de la famille royale, tout en contribuant aux décors de plusieurs grandes demeures, à l’image des appartements de la reine Marie-Thérèse au palais des Tuileries. C’est cependant au château de Saint-Cloud, propriété de Monsieur depuis 1658, que son talent sera tout particulièrement mis à contribution. Il interviendra ainsi largement dans le délicat décor des cinq pièces composant les appartements d’Henriette d’Angleterre. C’est pour son antichambre que Nocret exécute ce grand portrait de famille dont l’extravagance, la vigueur des couleurs et l’abondance de fleurs correspondaient à l’atmosphère du château et de ses jardins, dédiés aux plaisirs par un prince fantasque. Lorsque l’artiste s’éteint, épuisé, en 1672, cette composition magistrale sera unanimement considérée comme son chef-d’œuvre.

Louis XIV-Apollon en cours de restauration. © château de Versailles / T. Garnier
Sauvé des flammes
L’œuvre de Nocret serait-il maudit ? La malheureuse Henriette ne profitera guère du décor sur-mesure imaginé pour elle : elle s’éteint prématurément à l’âge de 26 ans, le 30 juin 1670. Nouvelle épouse de Monsieur, la princesse Palatine prend possession de ses appartements : on imagine sans peine sa joie de devoir désormais vivre au milieu de ces décors à la gloire de sa devancière ! Un siècle plus tard, Louis XVI rachète le domaine aux Orléans : le tableau est saisi en 1792 et entre à Versailles. Ce n’est qu’en 1814 que Louis XVIII, qui envisageait alors de s’installer au château, le fait insérer dans les boiseries du salon de l’Œil-de-Bœuf. Ce dernier accueillait jusqu’à la Révolution une grande toile de Véronèse, Esther et Assuérus (aujourd’hui au Louvre), dont le sujet, plus austère, correspondait au goût de Louis XIV pour la grande peinture française et italienne, mis en lumière dans la remarquable exposition que le château consacrait récemment aux tableaux de la chambre du Roi-Soleil (voir EOA n° 601, p. 8). La monumentale toile de Nocret échappa ainsi à l’incendie qui en 1870 ravagea Saint-Cloud et eut raison des autres décors de l’artiste. Quelques mois plus tard, ceux qu’il avait exécutés pour les appartements de la Reine disparaissaient à leur tour dans le brasier des Tuileries…
« Le cliché en « fausses couleurs » met de son côté en évidence l’utilisation véritablement massive du lapis-lazuli pour la couleur du ciel et la teinte de certains costumes. »
Un tableau peint à l’or bleu
Déposée pour la dernière fois entre 1984 et 1986, La Famille royale dans l’Olympe nécessitait une restauration fondamentale. Soutenue par la Société des Amis de Versailles et la Fondation du patrimoine, elle s’achève aujourd’hui après 14 mois et permet de mieux appréhender le travail d’un artiste encore méconnu dont l’œuvre fut martyrisé par les aléas de l’Histoire. Le dossier d’imagerie scientifique livré par le C2RMF documente ainsi la genèse de l’œuvre. La réflectographie infrarouge révèle ainsi plusieurs repentirs autour de la reine Marie-Thérèse. Comme le montre le dessin préparatoire conservé au musée Fabre de Montpellier, l’épouse de Louis XIV n’était initialement accompagnée que du Grand Dauphin, alors nettement plus jeune. Nocret a dû adapter son œuvre au rythme des naissances successives, ajoutant d’abord la « Petite Madame », puis dans un second temps le poupin duc d’Anjou, peint par-dessus les drapés aux couleurs vives habillant la souveraine. Le cliché en « fausses couleurs » met de son côté en évidence l’utilisation véritablement massive du lapis-lazuli pour la couleur du ciel et la teinte de certains costumes. Venu d’Afghanistan, il est alors considéré comme un véritable « or bleu ». « Nocret y a manifestement eu accès dans des proportions très importantes, ce qui est rare à l’époque, précise Élodie Vaysse, conservatrice du patrimoine en charge à Versailles des peintures des XVIe et XVIIe siècles. Même Poussin ou Le Brun n’ont pas eu cette chance ! » Un précieux pigment qui au fil des années avait disparu sous d’épais vernis jaunis qui conféraient à la scène une atmosphère automnale ; leur dissolution et le retrait des repeints ont permis de rendre à ce divin aréopage ses couleurs printanières. Il a par ailleurs fallu doter la toile d’un nouveau châssis : datant sans doute de 1818, l’ancien était déformé et excessivement lourd : « la dépose de l’œuvre a été particulièrement compliquée car elle pesait à cause de lui environ 200 kilos. Huit personnes ont été nécessaires pour la descendre par l’escalier de la Reine, un matin à 7h30, se souvient la conservatrice. Ce fut totalement épique ! ». Désormais installé, le châssis moderne en aluminium qui sert de support à la toile ne pèse plus que 70 kilos ; il facilitera grandement le remontage et assurera une meilleure conservation de l’œuvre.

Jean Nocret (1615-1672), La Famille d’Apollon. Plume et encre brune, lavis gris, rehauts de gouache blanche, mise au carreau à la pierre noire sur papier vergé, 28,5 x 37,8 cm. Montpellier, musée Fabre. © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / Frédéric Jaulmes
Le tratteggio au secours de la « Petite Madame »
Un œil attentif remarquera peut-être qu’une petite partie du tableau ne date pas du Grand Siècle, mais de septembre 2023. Une zone d’une trentaine de centimètres située au niveau du buste de la troisième fille de Louis XIV avait en effet été déchirée et remplacée au XIXe siècle par une incrustation de toile. Il a été décidé de relever puis de supprimer le repeint, sauf au niveau de la guirlande de fleurs qui a simplement été rehaussée et harmonisée. Les restaurateurs se sont inspirés d’autres portraits d’enfants par Nocret afin de compléter le tableau à l’aide de la technique entièrement réversible du tratteggio qui, au moyen de fines hachures, permet une réintégration de lacunes clairement identifiable en vision rapprochée.
Réunir la famille royale
L’ouvrage consacré à Nocret qui, dans quelques mois, paraîtra sous la plume d’Élodie Vaysse, traduit bien l’intérêt nouveau que suscite l’artiste. Ces dernières années, plusieurs de ses œuvres sont judicieusement venues compléter les collections de Versailles. En juin dernier, le château s’enrichissait ainsi d’un portrait historié d’Henriette d’Angleterre en Flore ou en Aurore, trois ans après avoir reçu en don, par l’intermédiaire des Amis de Versailles, un portrait du Grand Dauphin enfant peint vers 1663-1664. Plusieurs tableaux conservés de longue date au château ont par ailleurs pu être rendus au peintre lorrain, à l’image d’une autre effigie d’Henriette d’Angleterre peinte vers 1660 dans laquelle la princesse tient entre ses bras son chien favori. Répondant au nom de « Mimi », ce petit épagneul papillon aux distinctifs pendants d’oreilles en corail se retrouve également dans un portrait d’enfant par Nocret exposé par la galerie parisienne Franck Baulme Fine Arts à Bruxelles lors de la dernière édition de la BRAFA. Sa présence et la comparaison des traits de la petite fille avec ceux de l’aînée de Monsieur, représentée entre ses parents en Iris sur la grande toile de Versailles, permettent au galeriste de proposer d’y voir un portrait de la jeune Marie-Louise d’Orléans (1662-1689). Le faste de sa représentation ne lui épargnera pas un destin tragique : mariée au malheureux Charles II de Habsbourg dit « l’Ensorcelé », roi d’Espagne que des générations de consanguinité avaient rendu physiquement et intellectuellement inapte à l’exercice du pouvoir, elle s’éteindra, comme sa mère, à l’âge de 26 ans, empoisonnée… ou bien plus vraisemblablement victime d’une intoxication alimentaire. Cette toile n’aurait-elle pas toute sa place aux côtés des portraits d’enfants royaux par Nocret déjà rassemblés par Versailles ?

Jean Nocret (1615-1672), Portrait présumé de Marie-Louise d’Orléans (1662-1689), vers 1665. Huile sur toile, 56 x 80 cm. Paris, F. Baulme Fine Arts. © F. Baulme Fine Arts
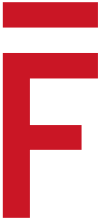
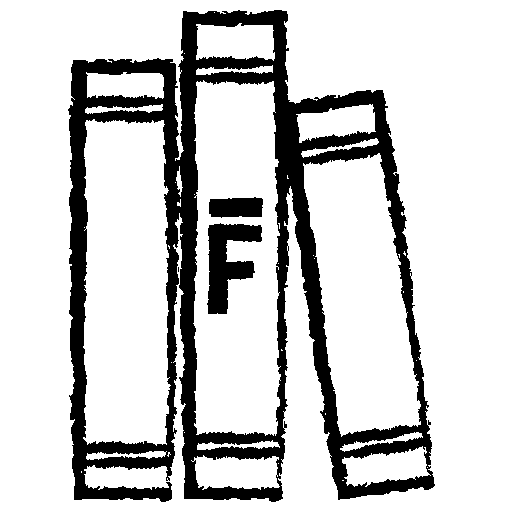
d’expertise éditoriale
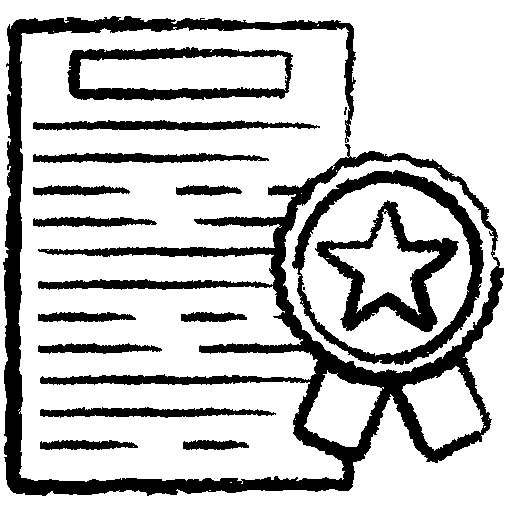
et fiabilité
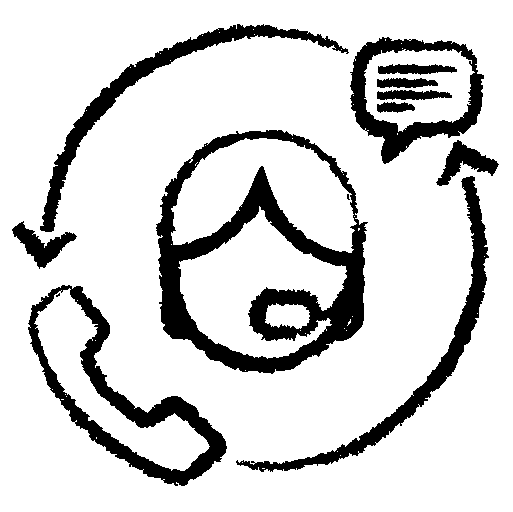
à l’écoute
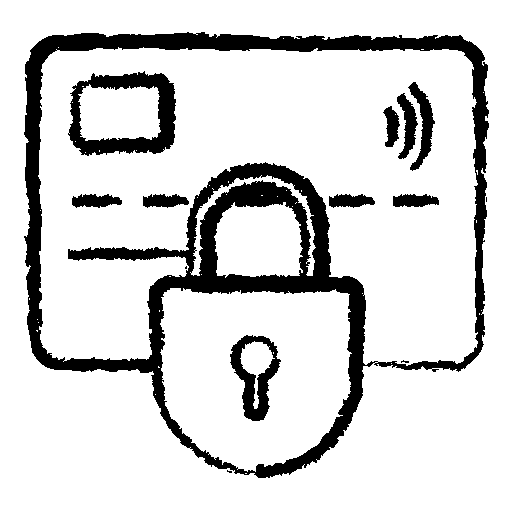
100% sécurisé