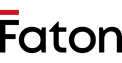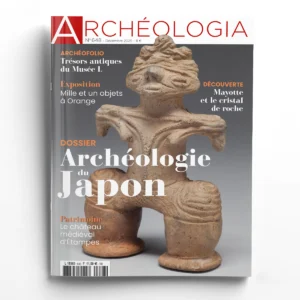Sceaux au temps de la duchesse du Maine

Petite-fille du Grand Condé, Anne Louise Bénédicte de Bourbon (1676-1753), duchesse du Maine, se révéla aussi extravagante que son époux, fils naturel du Roi-Soleil, fut effacé. Véritable « animal politique », cette princesse du sang qui se rêvait en reine fit durant la première moitié du XVIIIe siècle de son château de Sceaux un théâtre à la mesure de ses ambitions et de sa magnificence.
Figure éminente de la haute aristocratie déclassée par son mariage avec Louis Auguste de Bourbon (1670-1736), fils bâtard de Louis XIV et de la marquise de Montespan issu d’un double adultère, celle que l’on surnommera bien vite « Ludovise » semble bien mal assortie à son époux, homme de cabinet d’un naturel discret affublé par le sort d’un pied bot. Le statut social bancal que lui inflige cette mésalliance constitue vraisemblablement l’une des clés de lecture de la personnalité excentrique de la duchesse, à la fois autoritaire et extravagante, frivole et précieuse, savante et frondeuse ; « chamarrée », résumait l’acerbe Saint-Simon.
« Impossible d’avoir plus d’esprit, plus d’éloquence, plus de badinage, plus de véritable politesse ; mais, en même temps, on ne saurait être plus injuste, plus avantageuse, ni plus tyrannique. »
Président Hénaul
N’hésitant jamais à rappeler à son époux l’infériorité de sa condition, la duchesse lui assurera néanmoins un soutien croissant à mesure que le déclin du Roi-Soleil et la disparition de ses héritiers le rapprochent du trône. En 1714, c’est la consécration : reconnu apte à succéder au monarque en cas d’absence d’héritier légitime, le duc du Maine se voit offrir en vertu des dispositions testamentaires du vieux roi une place de choix auprès du futur Louis XV. Bénéficiant du soutien des princes du sang, qui considèrent cette position comme un affront, le duc d’Orléans fera casser le testament de feu Louis XIV par le Parlement, écartant du pouvoir le duc et sa trop ambitieuse épouse. En 1718, cette dernière sera l’instigatrice de la rocambolesque conspiration de Cellamare visant à renverser le Régent. Son échec retentissant la conduira brièvement en prison et douchera ses ambitions politiques. La fière Ludovise s’occupera dès lors de tenir son rang, affirmant par son mécénat artistique le prestige de sa naissance.

Jacques Rigaud (1680-1754), Vue du château de Sceaux du côté de la grille, 1736. Estampe colorisée. © Tallandier / Bridgeman Images
Un patrimoine aujourd’hui lacunaire
Cette facette de son existence demeura longtemps relativement méconnue, éclipsée par son activisme politique et rendue difficilement lisible par le peu d’édifices, d’ensembles décoratifs ou de peintures parvenus jusqu’à nous. En effet, parmi ses nombreuses résidences, seul son hôtel parisien de la rue de Varenne, actuel hôtel Biron, a traversé les siècles intact. Le fastueux hôtel du Maine, rue de Bourbon, qu’elle dût quitter en 1736 à la mort de son époux, a été rasé, à l’instar du château de Sceaux et du pavillon de l’Arsenal, tandis que son château d’Anet n’échappa que de justesse à une destruction totale. Les représentations et vestiges de leurs intérieurs étant rares, seules quelques descriptions contemporaines permettent de s’en faire une idée précise et de tenter de reconstituer le goût de la duchesse.

Anonyme, Médaille de l’ordre de la Mouche à miel, 1703 (refonte du XIXᵉ siècle, avers). Bronze argenté, 2,8 cm. Sceaux, collection particulière.

Anonyme, Médaille de l’ordre de la Mouche à miel, 1703 (refonte du XIXᵉ siècle, revers). Bronze argenté, 2,8 cm. Sceaux, collection particulière. © CD92 / Dominique Brême
François de Troy, peintre de la duchesse du Maine
L’ambitieuse maîtresse de Sceaux ne pouvait se priver des services d’un peintre officiel afin d’immortaliser sa cour : vraisemblablement plus accommodant que ses confrères Rigaud et Largillière, François de Troy (1645-1730) eut l’heur de plaire à l’impossible duchesse. Considérée comme son chef-d’œuvre, la toile qu’il présente au Salon de 1704 élève Ludovise au rang de souveraine mythique : Le Festin de Didon et Énée (voir ouverture du présent article) dépeint en effet le couple ducal sous les traits du héros troyen et de la reine de Carthage, entouré d’une vaste cour ; vêtue de blanc et d’or, parée de perles et de pierres précieuses, la princesse du sang affirme son rang et son faste, alanguie sur un large lit à l’antique. En représentant autour d’elle les familiers de la cour de Sceaux, le peintre livre ici le plus important portrait historié français du règne de Louis XIV. Passée en vente chez Sotheby’s à New York, cette œuvre insigne a pu gagner en 2007 les cimaises de Sceaux. Quelques années plus tôt, le musée avait déjà pu acquérir une œuvre plus intimiste de l’artiste, qui vers 1702 mettait en scène l’érudition de la duchesse en pleine leçon d’astronomie.

François de Troy (1645-1730), La Leçon d’astronomie de la duchesse du Maine, vers 1702. Huile sur toile, 95,5 x 130,5 cm. Sceaux, musée du Domaine départemental de Sceaux. © CD92 / B. Chain
Reine de Sceaux
À l’aube du XVIIIe siècle, Ludovise délaisse Versailles pour Sceaux afin d’y établir sa propre cour. Le domaine s’impose dès lors comme un véritable foyer d’opposition depuis lequel l’orgueilleuse duchesse entend tenir tête au rival versaillais, prenant modèle sur ce que son grand-père, le Grand Condé, avait fait de Chantilly. À l’image de Voltaire, poètes et littérateurs s’y pressent bientôt, prenant part aux innombrables divertissements qui firent la gloire du domaine. Occupant les terribles insomnies de la duchesse, les féériques Grandes Nuits de Sceaux en constitueront, en 1714-1715, l’apothéose. Afin de redécorer selon sa fantaisie les intérieurs du château de Colbert, délaissé depuis le décès du fils du ministre en 1690, elle fait appel au peintre Claude III Audran (1658-1734) et au sculpteur Jean-Baptiste Poultier (1653-1719). Ils réaliseront notamment en 1704, dans son Petit appartement situé au deuxième étage, le décor d’une petite galerie, ainsi que celui du cabinet des Arts et des Sciences, joyau récemment étudié par Dominique Brême et Catherine Cessac à partir de l’identification d’un panneau peint en collection particulière. Un théâtre est également aménagé au premier étage, tandis qu’à proximité, le Petit Château dédié aux enfants du couple se voit doter de splendides jardins accueillant une volière, différentes fontaines, ainsi qu’un bassin orné d’un automate.
Une ménagerie politique
En 1720, à son retour d’exil, la duchesse charge l’architecte Jacques de La Guêpière (mort en 1734) d’ériger sur le site de l’ancien moulin à vent de Colbert transformé en jardin un charmant bâtiment cruciforme : le pavillon de la ménagerie. Simple maison de plaisance de prime abord, il semble en réalité constituer un rouage essentiel de la propagande politique déployée par Ludovise. Affirmant la puissance d’un monarque ou d’un prince capable de réunir en un même lieu les espèces les plus exotiques, l’installation d’une ménagerie par la duchesse n’a en effet rien d’anodin. Vraisemblablement inspirée par celle de Versailles, érigée dans les années 1660 par Le Vau, puis réaménagée en 1698 pour la jeune duchesse de Bourgogne, elle en réutilise la structure octogonale pour les deux pièces (antichambre et chambre à alcôve) flanquant le salon central circulaire. Donnant accès au toit-terrasse, un salon faisant office de belvédère pouvait, comme à Versailles, servir d’observatoire astronomique. Si la composition de l’édifice en volumes simples (cercle, croix, octogone) rappelle bien sûr le pavillon de l’Aurore bâti du temps de Colbert, le raffinement de son ornementation et l’élégant équilibre de ses proportions annoncent déjà le Pavillon français que Gabriel dessinera à Trianon au milieu du siècle. En 1736, l’inventaire après décès du duc révèle la préciosité de son décor intérieur, déployant chinoiseries et boiseries rocaille. Mentionnant la présence de quelques vaches, il laisse entendre qu’à la différence de la ménagerie royale, celle de la duchesse n’accueillit vraisemblablement jamais d’espèces exotiques et demeura essentiellement symbolique.

Coupe et profil de la ménagerie de Sceaux pris sur la longueur du bâtiment, in Jean Mariette, L’architecture françoise, 1727. © DR
Un décor à la gloire de la « dictatrice perpétuelle »
Alors que la ménagerie de Versailles, négligée par Louis XV, amorce son déclin, celle de la reine de Sceaux éblouit, accueillant spectacles, feux d’artifice et dîners somptueux. Les ambitions politiques de la duchesse s’affichent ostensiblement sur le fronton de la façade principale où est représentée une ruche monumentale entourée de personnages à genoux. Pour les convives, le message est clair : il s’agit là d’une évocation de l’ordre de la Mouche à miel, parodie des ordres de chevalerie et de l’Académie française créée en 1703 par la duchesse, qui s’en était autoproclamée « dictatrice perpétuelle ».
La reine des abeilles
Moquée pour sa petite taille, elle se plaisait à jouer la reine des abeilles, insecte minuscule mais venimeux. Cette iconographie se prolongeait sur les frontons latéraux, développant une idéologie pastorale subversive. Contestant l’ordre établi, tout en soulignant ses liens avec la monarchie, la ménagerie et son décor traduisaient pleinement les ambitions intellectuelles et politiques de Ludovise. Le pavillon ne survécut guère à sa commanditaire : il sera rasé en 1798, en même temps que le château, par Jean-François Hippolyte Lecomte, nouveau propriétaire du domaine. Seul subsiste aujourd’hui, dans le jardin de la Ménagerie, le tracé des fondations ainsi que deux émouvants témoignages de l’amour de la duchesse pour ses animaux : les colonnes abritant les tombes de ses serins ainsi que l’urne de son chat adoré, accompagnée de l’épitaphe « Icy gît Mar-la-Main, le roi des animaux ».
La commode du « cabinet de la Chine »
En 2005, Sceaux avait pu acquérir l’exceptionnelle commode Régence commandée par la duchesse du Maine au début des années 1730 afin d’orner son cabinet exotique. Vraisemblablement exécutée par Bernard II van Risamburgh (1705-1766), elle déploie une garniture de bronzes ciselés et dorés du plus grand raffinement encadrant des panneaux en laque polychrome de Coromandel issus d’un unique paravent d’époque Kangxi. Se substituant au marbre, l’un des panneaux forme ici le plateau de la commode, fait unique dans l’histoire du goût français de l’époque.

Bernard II van Risamburgh (1705-1766), commode de forme galbée en laque de Coromandel, vers 1730. Chêne, sapin, noyer, laque de Coromandel, bronze ciselé et doré, 82,5 x 126 x 54,5 cm. Sceaux, musée du Domaine départemental de Sceaux. © CD92 / Ph. Fuzeau
Le goût de la Chine
À la mort de la duchesse en 1753, vingt-sept vacations seront nécessaires afin de disperser les 3 065 lots provenant de ses six résidences. Fidèle à son image de femme de lettres, Ludovise avait notamment réuni à Sceaux une importante bibliothèque de 1 721 volumes imprimés. Férue de musique, elle y avait aussi rassemblé un grand nombre d’instruments, parmi lesquels figurent deux clavecins et un orgue. Si la peinture et la curiosité ne firent à l’évidence pas partie de ses principales passions, son domaine témoigne, à l’inverse, d’un intérêt certain pour la petite statuaire européenne et les objets en cristal de roche. Véritable érudite, la duchesse se passionnait par ailleurs pour les instruments scientifiques, essentiellement présentés à Sceaux. La principale caractéristique du goût de Ludovise réside cependant dans son amour immodéré pour les chinoiseries alors en vogue.

Allégorie de l’ordre de la Mouche à miel (La Meule), panneau du décor du cabinet des Arts et des Sciences du château de Sceaux, 1704. Huile sur panneau de chêne, 185 x 90 cm. Paris, collection particulière. © Luc Paris
Une collection exceptionnelle de céramiques
Dès les années 1720, elle avait fait aménager plusieurs « cabinets de Chine », l’un dans son hôtel parisien et l’autre au rez-de-chaussée du château de Sceaux, écrin somptueux dont les murs étaient ornés de miroirs et probablement de panneaux de lambris en laque. Meublé de sièges en bois doré recouverts « d’étoffe de Constantinople fonds d’or à figures chinoises » et d’une « table à écrire de bois verny de la Chine », il accueillait les précieuses créations d’Extrême-Orient dont raffolait la maîtresse des lieux. Si elle fit vraisemblablement l’acquisition auprès de la « Manufacture royale pour les beaux vernis de la Chine » des frères Martin de sept petits meubles, son goût la portait plutôt à rechercher de véritables pièces orientales. Parmi elles, les intimes de la duchesse pouvaient admirer une fontaine à parfum bleu céleste d’époque Kangxi (1661-1722) montée en bronze doré, que Sceaux a pu s’offrir en 2014. Au total, le seul château servait à l’époque d’écrin à plus d’un demi-millier de céramiques orientales, auxquelles s’ajoutait une sélection de magots et pagodes. La passion de la duchesse s’étendait également aux laques, principalement conservées en son hôtel parisien, ainsi qu’à la porcelaine européenne, et notamment de Saxe. Au soir de sa vie, elle accorda ainsi sa protection à l’installation d’une faïencerie à proximité du Petit Château.
À lire :
Catherine Cessac et Manuel Couvreur, La duchesse du Maine (1676-1753) : une mécène à la croisée des arts et des siècles, éditions de l’Université de Bruxelles, 2003, 288 p.
Dominique Brême et Catherine Cessac, Les caprices de Ludovise. Un décor retrouvé de l’ancien château de Sceaux, Silvana Editoriale, 2019, 135 p.
L’Objet d’Art hors-série n° 156, 64 p.
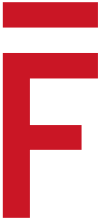
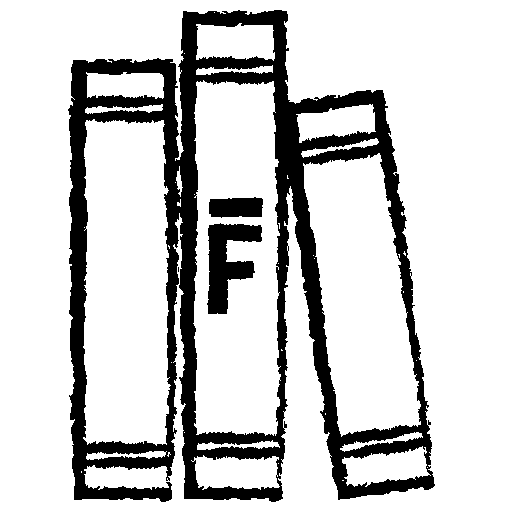
d’expertise éditoriale
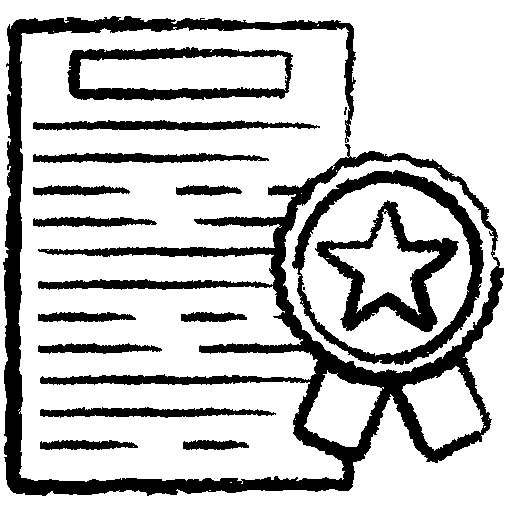
et fiabilité
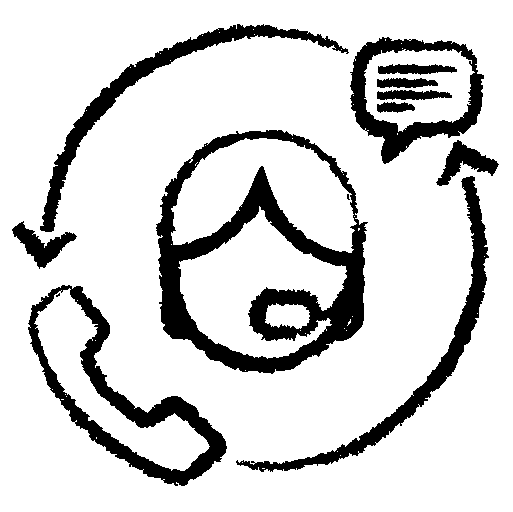
à l’écoute
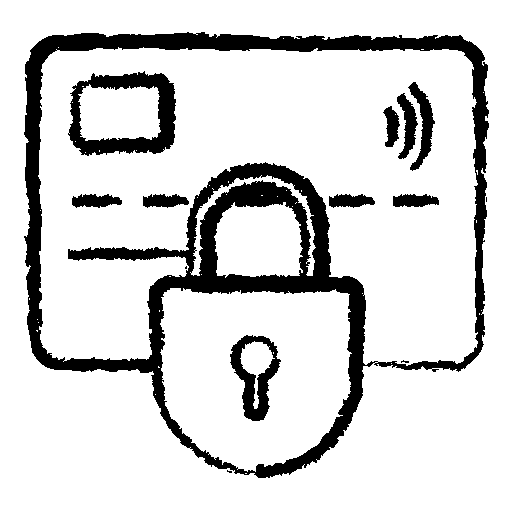
100% sécurisé